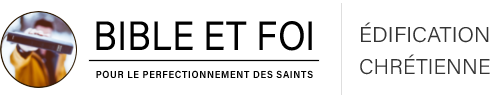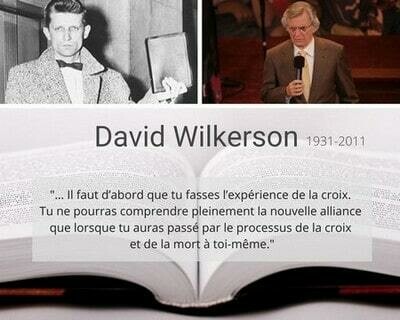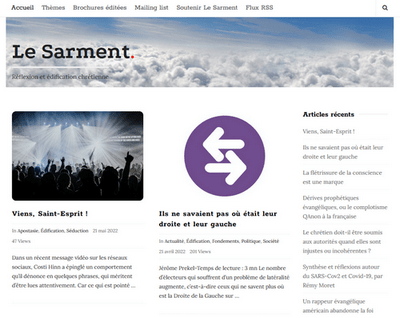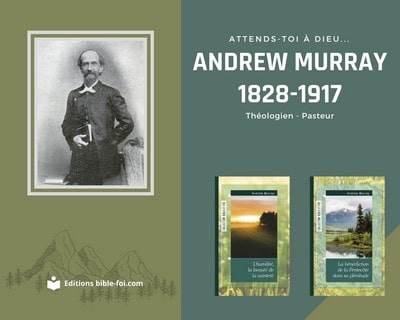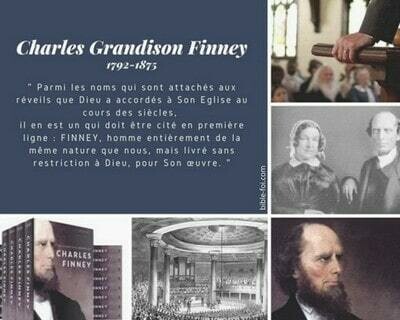
Mesures pour favoriser les réveils.14
L’objet des apôtres devait être de faire connaître l’Évangile de la manière la plus efficace, de lever le plus haut possible l’étendard de la vérité, et de manière à attirer l’attention et à s’assurer l’obéissance du plus grand nombre.
« Ces hommes-ci, qui sont juifs, troublent notre ville ; car ils annoncent des maximes qu’il ne nous est pas permis de recevoir, ni de garder, vu que nous sommes romains (Actes 16 v. 20 et 21) ». « Ces hommes, » dont il est parlé ici, étaient Paul et Silas qui s’étaient rendus à Philippes pour y prêcher l’Évangile. Les habitants de cette ville, craignant que cela ne portât atteinte à leur gain terrestre, traînèrent les apôtres de la place publique devant les magistrats et les gouverneurs, en les accusant d’enseigner des maximes, et particulièrement d’employer des mesures qui n’étaient pas légitimes.
Je me propose, en discourant sur ces paroles, de montrer :
I. Que, sous la dispensation évangélique, le Seigneur n’a établi, pour faire fleurir la religion, aucun système particulier de mesures à employer, auxquelles il faudrait être invariablement attaché.
II. Que nous ne sommes arrivés que par degrés, et par une succession de mesures nouvelles aux formes de service public que nous avons présentement, et qu’en général ce n’est que par gradation qu’on arrive à des mesures quelconques, relatives au règne de Dieu.
I. Sous l’Évangile, Dieu n’a pas déterminé de mesures particulières à employer.
Sous la dispensation juive, il y avait des formes spéciales enjointes et prescrites par Dieu lui-même, et desquelles il était illégitime de s’écarter. Mais toutes ces formes-là étaient des types, une ombre dont le corps était en Christ ; ou du moins elles se rapportaient de manière ou d’autre à la nouvelle dispensation que Jésus allait introduire ; et c’est pourquoi elles étaient établies par l’autorité divine, jusque dans les moindres détails. Mais sous l’Évangile il n’en fut jamais ainsi. A la venue de Jésus-Christ la dispensation cérémonielle ou typique fut abrogée, parce que, le but de ces formes étant atteint, leur dessein effectué, elles ne pouvaient plus désormais être d’aucun usage.
Les types firent place à l’anti-type. Alors c’est l’Évangile lui-même qui fut prêché, comme le véritable moyen d’avancer et de répandre la religion ; mais les mesures à employer, les formes à suivre pour lui donner sa puissance, furent laissées à la discrétion de l’Église. Si l’on en excepte quelques lueurs, quelques insinuations qui percent occasionnellement clans le livre des Actes, et qui peuvent alors nous guider dans notre conduite à cet égard, nous sommes dans une complète obscurité sur les mesures qu’adoptèrent et suivirent les apôtres et les premiers prédicateurs de l’Évangile.
Nous ne savons pas le temps qu’ils mettaient à chanter, à prier, dans leurs réunions, ou si même ils chantaient ou priaient du tout lorsqu’ils s’assemblaient pour la prédication. Jésus, étant sur la terre et travaillant parmi ses disciples, n’eut rien à faire avec des formes ni des mesures fixes. De temps en temps, il est vrai, il s’en servait ; mais c’était dans des cas où tout homme aurait fait la même chose, mais il n’y était nullement assujetti : C’est ce dont les Juifs se plaignaient, ce dont ils l’accusaient.
Son objet, son but était de prêcher et d’enseigner au genre humain la véritable religion. Et quand, après lui, les apôtres, revêtus de l’Esprit d’en haut, prêchèrent l’Évangile, nous ne voyons nulle part qu’ils aient reçu l’ordre de suivre, non plus, aucun système particulier, aucun plan dressé pour les diriger dans leur œuvre ; ou que l’un d’eux embrassât telle mesure par la seule raison qu’elle était employée par d’autres : « Allez par tout le monde, prêchez l’Évangile à toute créature, et enseignez toutes les nations (Marc 16 v. 15) ». Tel est l’ordre qu’ils reçurent de leur maître, et cet ordre n’impliquait aucune forme, c’est en vain qu’on prétendrait y trouver des directions particulières.
Exécutez cet ordre, du mieux que vous le pourrez ; demandez à Dieu la sagesse qui vous manque, utilisez les facultés qu’il vous a données ; recherchez les directions du Saint-Esprit, et mettez-vous à l’ouvrage. L’objet des apôtres devait être de faire connaître l’Évangile de la manière la plus efficace, de lever le plus haut possible l’étendard de la vérité, et de manière à attirer l’attention et à s’assurer l’obéissance du plus grand nombre. Prêcher l’Évangile ; voilà ce qui importe, voilà la grande affaire. Quant aux formes, il n’en est pas question.
Je ne disconviens pas que, relativement à la prédication de l’Évangile, il n’y ait telles ou telles mesures qui doivent être adoptées. Il faut que les pécheurs l’entendent, et pour qu’ils le puissent, on prend les mesures nécessaires ; on bâtit des églises, on tient des réunions régulières ou non, etc. Il est évident que, sans des mesures quelconques, l’Évangile ne pourra jamais produire d’effet parmi les hommes ; mais l’Écriture n’en précise aucune.
II. Notre culte n’est parvenu aux formes qu’il a maintenant, que par gradation et par une suite d’innovations.
1. Et d’abord, pour ce qui regarde le ministère.
Il y a déjà bien des années que les ministres portaient tous un costume particulier, comme cela se voit encore maintenant dans les pays catholiques. Il en était de même dans cette contrée. Les ministres avaient leur uniforme comme les soldats ont le leur. Ils portaient des chapeaux à bords relevés, un rabat au lieu de col ou de cravate, des culottes courtes et la perruque. Qu’un homme eût peu de cheveux ou beaucoup, peu importait, il devait se les couper et porter la perruque ; puis venait la robe. Il eût été inconvenant d’officier sans être arrangé de la sorte. Or, bien certainement l’on n’est parvenu à ce costume que par une longue série d’innovations, car nous sommes fondés à croire que les apôtres, et les ministres qui les suivirent dans les premiers temps, ne se distinguaient en rien des autres hommes par leur mise.
Maintenant ces choses sont tombées en désuétude, l’une après l’autre, par suite de mesures nouvelles ; en sorte qu’il y a beaucoup d’églises où un ministre pourrait prêcher, vêtu comme ses auditeurs sans qu’on y fit le moins du monde attention. Cependant l’Église qui voyait partir une à une toutes les pièces du costume de ses ministres criait à l’innovation, et s’en plaignait comme si ces choses eussent été d’institution divine. Quand les chapeaux à bords relevés firent place à des chapeaux ordinaires, les vieilles gens en furent très vexés : « C’est déshonorant pour un ministre », disaient-ils, « de porter des chapeaux ronds ». Lorsqu’en 1827 je pris un bonnet fourré, un ministre me fit la remarque que c’était « indécent ».
Il y a peu d’années qu’on se récria contre ceux qui portaient des chapeaux blancs ; beaucoup de personnes pensèrent que c’était là une triste et indigne innovation. Actuellement même, on est si bigot dans quelques endroits, qu’un ministre me disait, il y a peu de jours, qu’il avait remarqué, dans un voyage qu’il fit l’été dernier dans la Nouvelle-Angleterre, que son chapeau blanc avait porté atteinte à son autorité.
Cet esprit est loin d’être excusable ; j’ai de bonnes raisons pour en être certain. Quelques hommes sensés ne virent là que de la bigoterie ; mais ils risquent bien de considérer sous ce même jour tout ce qui regarde la religion. Cette crainte des innovations est une chose grave. A peine trouveriez-vous, à l’heure que je vous parle, un seul ministre, dans ce pays, qui ne se sente tenu et obligé de porter un chapeau noir, comme si cet usage était établi de Dieu. Or, le respect pour ces choses est poussé jusqu’à la superstition ; et c’est une pierre d’achoppement pour un grand nombre d’esprits.
Il en fut de même quand les ministres déposèrent leurs rabats pour prendre des cravates, ou des cols. On disait qu’ils allaient devenir séculiers ; on y trouvait beaucoup à redire ; et actuellement encore, il y a telle église où un ministre n’oserait pas paraître en cravate, et où l’on croirait être sans ministre si on ne lui voyait pas de rabat. Il y en a un dans cette ville qui demandait l’autre jour si cela ferait quelque chose de prêcher en cravate blanche. Il en portait ordinairement une, mais il ne savait pas s’il était convenable de la mettre lorsqu’il monterait en chaire.
De même pour les pantalons à mi-jambe, qu’on regardait comme essentiels au caractère et à la vocation du ministre, et que l’on porte encore, actuellement dans les pays catholiques. Vous savez que de petits garçons même, élevés pour la prêtrise, portent nécessairement ce vêtement-là, de même que le chapeau retroussé et les bas noirs. Chez nous la chose paraîtrait maintenant ridicule : Mais un temps fut où les braves gens eussent tremblé pour l’église et cru voir crouler ses fondements, si un ministre était monté dans la chaire en pantalon.
On m’a dit que dans la Nouvelle-Angleterre (il y a déjà quelques années, il est vrai), un vieux prédicateur était tellement opposé au pantalon, qu’il ne voulut en aucune manière laisser monter en chaire un jeune homme qui devait prêcher pour lui, et qui venait ainsi vêtu. « Comment ! » disait-il, « mes auditeurs croiraient que je leur présente un faquin s’ils vous voyaient un pantalon, et il s’élèverait certainement une grande rumeur parmi eux ». En sorte que ce jeune homme fut obligé d’emprunter le haut-déchausses du vieux papa, qui se trouva trop court pour lui et où il faisait une figure assez ridicule. Mais toute autre chose était préférable à la terrible innovation de prêcher en pantalon ! Heureusement que la raison a triomphé sur ce point-là comme sur quelques autres.
Même observation pour les perruques. Je me rappelle un ministre qui, quoique tout jeune, portait cependant une énorme perruque blanche. Les gens parlaient de la chose comme d’un droit divin, et ils eurent presque autant de peine à y renoncer que s’il se fût agi de la Bible. Les robes aussi étaient comme un des attributs du caractère ministériel ; et à l’heure qu’il est, dans beaucoup d’églises de ce pays, on ne pourrait voir un ministre monter en chaire, s’il n’avait une robe de soie flottante avec d’énormes manches aussi amples que son corps. Même dans quelques églises congrégationalistes de la Nouvelle-Angleterre, on ne saurait y renoncer. Or, je le demande, comment en est-on venu à supposer qu’un ministre, pour prêcher avec succès, doive avoir une robe et une perruque ? D’où vient que chaque ecclésiastique était obligé de se servir de ces choses ?
Comment se fait-il qu’on ait pu en abandonner aucune sans qu’il y ait eu froissement dans les églises ? Sans qu’elles aient été troublées pour un temps plus ou moins long par ces innovations ? Qui prétendrait que la cause de la religion en a reçu la moindre atteinte ? Or, il semblait pourtant que sans ces choses on pouvait difficilement rendre un culte à l’Éternel ; tandis que cet attachement à un usage ne faisait en aucune manière partie de la religion, je veux dire de la religion chrétienne.
C’était de la superstition toute pure. Lorsqu’on enleva aux hommes ces objets de prédilection, ils faisaient la même plainte que Micah : « Vous avez dérobé mes dieux ». Mais en les dépouillant d’un respect superstitieux, l’Église n’a fait qu’y gagner, et son caractère religieux n’en a pris que plus de développement. En résumé vous voyez donc que le costume des ministres de nos jours n’est parvenu au point où il en est que par une série d’innovations.
2. Venons-en à l’ordre du culte public.
Les mêmes difficultés ont surgi quand on voulut y apporter le moindre changement ; l’Église en effet croyait que Dieu lui-même avait établi le mode qu’elle suivait. J’entre dans quelques détails.
A. Livres de Psaumes. Autrefois on chantait les Psaumes mêmes de David. Peu à peu on essaya d’en faire admettre la traduction en vers. On le trouva très mal ; aussi y eut-il dans les églises grand tumulte et violente opposition quand les ministres tentèrent cette innovation. Mais la nouvelle mesure triompha.
Plus tard, lorsqu’on proposa une autre version mieux soignée, il y eut de nouveau beaucoup de débats et de disputes. Enfin arriva la version de Watts, qui maintenant encore est rejetée par beaucoup d’Églises. Plus tard qu’en 1828, me trouvant à Philadelphie, je fus informé qu’un ministre y prêchait à son troupeau une suite de discours sur la psalmodie, dans l’intention de lui faire adopter une meilleure version d’hymnes et de cantiques que celle qu’il possédait.
Encore aujourd’hui, vous trouverez dans beaucoup d’Églises des personnes qui sortiront, si vous indiquez un psaume ou un cantique dans un livre nouveau : Et si, par exemple, les psaumes de Watts étaient adoptés, ces personnes se retireraient et formeraient un troupeau distinct, plutôt que d’admettre une pareille innovation. Les mêmes oppositions ont été réveillées, quand, dans les réunions de prières, on voulut introduire les « Hymnes villageoises ».
Dans une congrégation presbytérienne de cette ville, la femme d’un ministre désirait, il y a peu d’années, introduire ces hymnes villageoises dans les réunions de prière pour femmes. Elle pensait qu’une mesure si modérée n’éprouverait pas la moindre difficulté. Mais quelques âmes scrupuleuses, ayant trouvé que ce livre avait été composé à la Nouvelle-Angleterre, refusèrent de l’admettre
B. Lecture des cantiques ligne par ligne. Autrefois que l’on ne possédait que peu de livres, le diacre avait coutume de se tenir devant la chaire et de lire une ou deux lignes à la fois d’un psaume ou d’un cantique ; puis on les chantait ; et il en lisait de nouveau une ou deux et ainsi de suite. Peu à peu, les livres devenant moins rares, on commença à chanter chacun sur le sien et de suite. Oh ! Quelle innovation ! Hélas ! Quelle confusion, quel désordre elle produisit ! « Comment les gens pouvaient-ils chanter les louanges de Dieu, quand ils n’entendaient plus la sainte voix du diacre lire ligne après ligne ! » car la sainteté de la chose paraissait, pour eux, consister principalement dans le ton que le diacre y mettait, et qui était tel que vous auriez difficilement pu dire s’il chantait ou s’il lisait.
C. Chœurs. Une autre innovation eut lieu. Pour que le chant fût mieux soigné, on jugea à propos d’avoir un chœur de chanteurs à part. L’opposition fut ardente. Oh ! Combien d’Églises furent divisées, partagées en deux, parce que le désir des ministres et de quelques personnes influentes était de former des chœurs de chanteurs pour favoriser les progrès de la musique sacrée ! On parlait toujours d’innovations, de nouvelles mesures ; l’on voyait déjà fondre de grands maux sur l’Église, parce que les chanteurs avaient des places qui leur étaient réservées et apprenaient des airs que les vieilles gens ne pouvaient pas chanter. Pareilles choses ne s’étaient pas passées dans leur jeunesse ; et ils ne pouvaient tolérer dans l’église ces lumières nouvelles !
D. Diapasons. Lorsqu’on cultiva la musique et qu’on forma des chœurs, le besoin d’un diapason se fit sentir. Auparavant, quand le diacre ou le clerc lisait une ligne après l’autre d’un cantique, il entonnait tant bien que mal, et le reste suivait de son mieux. Mais aussitôt que ceux qui conduisaient les chœurs se servirent de diapasons pour donner le ton avec plus de sûreté, quelle vaste confusion cela ne produisit-il pas ! Un ecclésiastique disait que dans la ville, il y avait un ancien qui se levait et quittait le temple toutes les fois que le choriste soufflait dans son instrument. « Allez-vous-en avec votre siffle, », disait-il ! « Comment, siffler dans la maison de Dieu ! » Il regardait la chose comme une profanation.
E. Musique instrumentale. Dans quelques congrégations on en vint graduellement à introduire divers instruments pour aider et soutenir les chanteurs. Dès qu’on se servit du violoncelle, il y eut une grande commotion, et les gens dirent qu’il n’y avait tout d’un temps qu’à avoir un violon dans la maison de Dieu ! « Quoi, disaient-ils, mais c’est un violon ! c’en a toute la forme ; c’est seulement un peu plus grand ! et qui peut se joindre à un culte où il y a un violon ! On en viendra bientôt à danser dans la maison de Dieu ! »... Qui n’a entendu parler de ces choses comme étant d’une importance capitale pour la cause de la religion et la pureté de l’Église ?
Des ministres, dans de graves assemblées ecclésiastiques, ont passé des jours entiers en discussion sur ce sujet. Il n’y a que peu d’années que, dans un synode de l’église presbytérienne, on parla sérieusement, et comme d’une chose digne de blâme, d’une église qui avait des orgues ; et, encore aujourd’hui, il y a beaucoup d’églises, où l’on ne souffrirait pas un orgue ; et si l’on disait à quelques-uns que les pécheurs vont tous en enfer, et ils n’en seraient pas la moitié aussi émus que si on leur annonçait l’acquisition d’un orgue.
Oh ! Combien n’y a-t-il pas d’endroits où vous pourrez pousser l’église à faire toute autre chose plutôt que de suivre une route naturellement tracée, une route facile, et de prendre les moyens les plus nécessaires, les plus propres et les plus sages pour accréditer la religion et sauver les âmes !
Pour toute coutume, toute pratique qui leur a été transmise ou qu’ils ont suivie eux-mêmes longtemps, quelque nuisible et absurde qu’elle soit, ils agissent comme s’ils avaient devant eux un ordre de Dieu, un « ainsi a dit l’Éternel ».
6° Prières spontanées. Que de personnes n’y a-t-il pas dans l’église anglicane, qui parlent du livre de prières comme s’il était d’institution divine ! C’est là ce que croient des multitudes ; et dans certains endroits on ne permettrait pas à quelqu’un de prier sans avoir son livre devant lui.
7° Prédication improvisée. Il n’y a que peu d’années, une dame de Philadelphie, invitée à entendre prêcher un certain ministre, s’y refusa parce qu’il ne lisait pas ses sermons. Elle semblait croire que ce serait une profanation à un homme de monter en chaire et de parler, juste comme s’il parlait aux gens de quelque sujet important et d’un grand intérêt. Comme si Dieu avait enjoint de prendre des notes et d’écrire ses sermons !
On ignore donc que les sermons écrits sont eux-mêmes une innovation, et une innovation moderne qui fut introduite en Angleterre dans les temps de difficultés politiques. Les ministres craignaient qu’on ne les accusât de prêcher contre le gouvernement, à moins qu’ils ne pussent montrer ce qu’ils prêchaient, l’ayant auparavant écrit d’un bout à l’autre. Et s’accommodant aux circonstances, ils cédèrent à ces considérations politiques et imposèrent à l’Église un joug pesant et détestable. Actuellement on y est habitué ; et dans beaucoup de localités on ne veut pas entendre parler de prédications improvisées.
8° Prier à genoux. Ceci encore a causé de grands troubles dans plusieurs parties du pays. Un temps était dans les églises congrégationalistes de la Nouvelle-Angleterre, où un homme, une femme auraient rougi d’être vus à genoux dans une réunion de prière, et d’être pris ainsi pour des méthodistes. J’ai prié dans des familles où j’étais la seule personne qui se mît à genoux, tous les autres restaient debout, de peur, je suppose, d’imiter les méthodistes et d’appuyer ainsi, de favoriser des innovations dans les formes établies. D’autres, au contraire, parlent comme si d’être à genoux était la seule posture acceptable devant Dieu.
3. Action des laïques.
A. Prières des laïques. Autrefois l’on s’opposait fortement à ce qu’un homme priât ou eût la moindre part à la direction d’une assemblée de prière, à moins qu’il ne fût ecclésiastique. On avait coutume de dire que, pour un laïque, prier en public c’était déroger à la dignité des ministres, et que ce n’était pas à tolérer. Un ministre de Pennsylvanie me disait qu’il avait voulu, il y a peu d’années, établir une réunion de prières dans l’église, mais que les anciens s’y opposèrent, et qu’on fut obligé d’y renoncer. Ils disaient qu’ils ne voulaient pas d’une œuvre I semblable ; qu’ils payaient un ministre pour qu’il fît la prière, et qu’il devait la faire ; qu’ils ne se souciaient pas de voir prier les hommes du commun.
Les ministres mêmes et beaucoup d’autres personnes se sont longtemps opposés à ce qu’un laïque priât en public, surtout en présence d’un ministre, disant que ce serait porter atteinte à l’autorité du clergé. Lors d’un synode qui se tint dans cet État, on arrêta une réunion synodale de prières. Pour faire la chose avec ordre, le comité désigna les personnes qui devaient y prendre part, et nomma deux ecclésiastiques et un laïque. Le laïque était un homme de talent et qui avait de l’instruction autant que la plupart des ministres. Mais un docteur en théologie fit de sérieuses objections à ce qu’on demandât à un laïque de prier devant ce synode. Il disait que ce n’était pas la coutume, qu’en le faisant on empiéterait sur les droits du clergé, et qu’il ne fallait pas d’innovations. Quelle superstition !
B. Exhortations des laïques. Une question de haute importance, et qui a agité toute la Nouvelle-Angleterre et beaucoup d’autres parties du pays, a été de savoir s’il était permis aux laïques d’exhorter dans les réunions publiques. Nombre de ministres se sont efforcés de leur fermer entièrement la bouche. Mais ces personnes oubliaient la pratique des églises primitives. Il y a près de cent ans qu’on s’opposait tellement à ces pratiques, que le président Edwards s’empara du sujet et écrivit une défense bien élaborée des droits et des devoirs des laïques.
Et malgré cela, cette opposition n’a pas encore entièrement cessé jusqu’à aujourd’hui. « Comment un homme qui n’est pas consacré, parle t'il en public ! Cela jettera de la confusion, abaissera le ministère ; que dira-t-on de nous, ministres, si nous permettons aux hommes du commun de faire les mêmes choses que nous ? » Mais, maintenant, il y a beaucoup de localités où les laïques peuvent prier et exhorter sans la moindre objection. Les maux qu’on craignait devoir résulter des travaux des laïques ne se sont pas réalisés, et bon nombre de ministres sont heureux d’utiliser pour le bien des âmes les dons des laïques.
C. Réunions de prières entre femmes. On a vivement combattu ces réunions dans ce pays, pendant les dernières années qui viennent de s’écouler, comme une chose terrible. Un ministre, qui est mort maintenant, disait que, lorsqu’il voulut établir ces réunions, tout le clergé se mit contre lui. « Faire prier des femmes ! Il n’y aura bientôt plus qu’à les faire prêcher ! » On craignait sérieusement pour la sûreté de Sion, en voyant des femmes se réunir pour prier ! A présent encore il y a des églises où cela ne serait pas toléré.
D. Il en a été de même par rapport à tous les mouvements un peu actifs de l’Église. Les missions, les écoles du Dimanche, toute autre chose de ce genre, tout a rencontré de l’opposition, toutes ces institutions ne sont parvenues au point où elles en sont que par une suite non interrompue de combats, d’efforts et d’innovations. Il y a quelques années qu’une association baptiste, dans la Pennsylvanie, rompit d’avance et en principe toute communion avec quelque ministre que ce fût, qui aurait reçu une éducation libérale ou qui soutiendrait les sociétés de missions, les sociétés bibliques, les écoles du Dimanche, les sociétés de tempérance, etc.
Toutes ces choses étaient dénoncées comme des mesures nouvelles qui ne se trouvaient pas dans la Bible et qui devaient nécessairement semer le trouble et la confusion dans les églises. La même chose s’est vue dans quelques églises d’Allemagne ; et dans beaucoup d’églises presbytériennes, il se trouve des gens sur ce même terrain qui dénonceront toutes ces choses comme des innovations, de nouvelles mesures, de nouvelles lumières, marchant dans leur propre force, etc., et calculées pour faire beaucoup de mal.
E. Je vais maintenant mentionner plusieurs hommes qui, par la Providence divine, se sont rendus remarquables en introduisant des innovations.
1° Les Apôtres étaient de grands innovateurs, comme vous le savez tous. Après la résurrection, et quand le Saint-Esprit eut été répandu sur eux, ils se mirent en effet à remodeler l’Église. Ils brisèrent, déracinèrent le système juif avec ses formes accoutumées, de manière à n’en laisser presque aucune trace.
2° Luther et les réformateurs. Vous connaissez tous les difficultés qu’ils eurent à combattre, difficultés qui provenaient de ce qu’ils travaillaient à introduire de nouvelles mesures, de nouveaux modes pour accomplir les devoirs publics de la religion, de nouveaux expédients pour appliquer l’Évangile avec puissance au cœur de l’homme. On retenait avec une opiniâtre obstination, comme étant d’autorité divine, tous les usages ridicules, étranges ou même idolâtres de l’Église catholique romaine ; et quand on voulut les changer, le trouble et l’excitation furent si grands, que peu s’en fallut que l’Europe entière ne fût mise à feu et à sang.
3° Wesley et ses collaborateurs. Wesley ne se sépara pas d’abord de l’Église établie d’Angleterre, mais il forma partout de petites classes qui devinrent comme des églises dans d’autres églises. Il resta dans l’Église épiscopale ; mais il y introduisit tant de nouvelles mesures, que l’Angleterre fut remplie de troubles, de soulèvements et d’opposition. Partout on le dénonçait comme un novateur, un séditieux qui enseignait des choses « nouvelles qu’il n’était pas permis de recevoir. » Whitefield était un homme de la même école, et, comme Wesley, novateur.
Je crois que lui et plusieurs de ses associés furent exclus du collège pour avoir introduit la mesure si nouvelle des réunions de prières en commun. Ils priaient ensemble et sondaient les Écritures ; et cette innovation ne put être tolérée. Lorsque Whitefield vint dans cette contrée, quelle opposition violente ne souleva-t-il pas ? Il courut souvent le danger de perdre la vie, et il ne s’en tira quelquefois qu’avec une grande difficulté. Maintenant chacun le regarde comme la gloire de son siècle Et, quant à Wesley, il y en a beaucoup, dans notre propre dénomination, qui ont assez déposé leur partialité pour voir en lui non-seulement un homme pieux, mais encore un homme sage et suréminemment utile. Mais, de leur vivant, l’Église presque tout entière les regardait avec animosité, craignant de périr par ces innovations.
4° Le président Edwards. Ce grand homme fut fameux en son temps pour les innovations. Il refusait, entre autres, de baptiser les enfants de parents impénitents. La pratique de baptiser les enfants, même ceux des impies, avait été introduite cent ans auparavant dans les églises de la Nouvelle-Angleterre, et était devenue presque universelle. Le président Edwards vit qu’elle était mauvaise et refusa de s’y conformer. Ce refus heurta violemment toutes les églises de la Nouvelle-Angleterre. Une centaine de ministres se réunirent et déterminèrent de le combattre. Il écrivit alors un livre sur ce sujet, et défit complètement ses ennemis. Cela produisit une excitation des plus puissantes qui aient jamais éclaté dans la Nouvelle-Angleterre ; et une guerre de révolution seule pourrait produire un bouleversement pareil à celui que causa cette innovation. Pourtant elle a passé.
L’association générale du Connecticut refusa de soutenir Whitefield : « C’était un si grand novateur ! Comment ! Il veut « prêcher en rase campagne ! partout ! Quelle chose effroyable », « qu’un homme qui prêche dans les rues, dans les campagnes ! Chassez ce misérable ! » Voilà ce qu’on disait.
Or, tous ces hommes-là étaient dévoués et recherchaient les meilleurs moyens de sauver les âmes et de faire du bien. Tous éprouvèrent le même genre d’opposition ; encombrés, entravés dans leur chemin, ils virent les églises chercher à anéantir leur œuvre et leur influence. On peut encore se procurer un livre écrit du temps d’Edwards par un docteur en théologie, et signé par une foule de ministres ; ce livre était dirigé contre Whitefield, Edwards et leurs associés.
Dans le temps de la dernière opposition qui eut lieu à New-York contre les réveils, on remit, à l’éditeur d’un journal religieux périodique, la copie d’une lettre qui avait été composée contre Whitefield, avec prière de la publier. Il refusa, donnant pour raison que, s’il la publiait, beaucoup de personnes en feraient l’application à la controverse qui avait eu lieu alors. Je n’en parle que pour montrer quelle parfaite identité il se trouve dans l’opposition élevée en tout temps contre les nouvelles mesures qui tendent à favoriser les progrès de la religion.
6. De nos jours, il s’est introduit dans l’Église plusieurs pratiques dont l’utilité a été reconnue, mais contre lesquelles on s’opposait pendant longtemps, par le motif que c’étaient des innovations. Et comme il y a encore aujourd’hui beaucoup de personnes qui n’ont pas une vue claire de ces pratiques, j’ai pensé qu’il serait bon de faire là-dessus quelques remarques.
Trois choses surtout ont particulièrement attiré l’attention : Les réunions pour les âmes travaillées (anxious meetings), les réunions prolongées, et le banc des âmes travaillées. Ces trois choses sont encore attaquées par plusieurs, et appelées de nouvelles mesures.
1. Réunions pour les âmes travaillées. C’est dans la Nouvelle-Angleterre que j’en entendis parler pour la première fois sous ce nom ; elles étaient destinées à des conversations personnelles avec les pécheurs inquiets, les instructions y étaient appropriées aux individus suivant leur cas, et tendaient à les conduire immédiatement à Jésus-Christ. Le but en est évidemment philosophique ; mais on s’y est opposé parce que c’était une chose nouvelle.
Il y a deux manières de conduire ces assemblées ; les deux sont également propres à atteindre leur objet.
1° La première, c’est de consacrer quelques moments à un entretien personnel, mais pourtant général, pour connaître l’état de l’âme de chacun de ceux qu’on a en vue ; puis, dans une exhortation adressée à tous, on combat leurs erreurs et on résout en même temps leurs difficultés.
2° La seconde, c’est d’aller de l’un à l’autre ; de prendre à part et d’examiner de même le cas de chaque individu ; puis de lui faire promettre, à lui, pris à part, de donner son cœur à Dieu. L’un et l’autre de ces moyens sont importants et ont été couronnés d’un grand succès dans la pratique.
2. Assemblées prolongées.
Celles-là ne sont point nouvelles ; elles ont toujours été pratiquées sous une forme ou sous l’autre depuis qu’il existe une église sur la terre. Les fêtes des Juifs n’étaient autre chose que des assemblées prolongées. Pour ce qui regarde la manière dont elles étaient conduites, on s’y prenait autrement que maintenant. Mais le but en était le même ; c’était de consacrer un certain nombre de jours consécutifs à des services religieux pour produire sur les esprits une impression plus puissante des choses divines. Les chrétiens de presque toutes les dénominations tiennent des réunions prolongées, quand la religion prospère réellement parmi eux.
En Écosse, elles avaient lieu à toutes les communions, depuis le jeudi jusqu’après le dimanche. Les épiscopaux, les baptistes, les méthodistes, tiennent tous des réunions de ce genre. Mais, encore maintenant, elles rencontrent de l’opposition, particulièrement chez les presbytériens ; on les a appelées des innovations, et on les a regardées comme un tissu de maux, quoiqu’elles aient été si grandement et si manifestement bénies. Je vais dire ici quelques-unes des choses qu’il faut considérer relativement à ces réunions.
a. Pour les établir, il faut avoir égard aux circonstances où se trouvent les personnes, et s’assurer que l’Église aura le temps d’y assister, et pourra y donner une attention convenable. Cette règle a été quelquefois négligée. Il y en a qui ont jugé bon de ne tenir aucun compte des affaires pressantes et des travaux obligés de la communauté, et qui, à la campagne, prenaient pour ces réunions le temps de la moisson, et à la ville celui où les hommes sont le plus affairés, où ils ont des occupations obligatoires et sont pressés de travaux temporels.
On dit, à l’appui de cette manière d’agir, que nos affaires doivent toujours passer après celles de Dieu ; que les choses éternelles sont d’une importance tellement supérieure aux temporelles, que les affaires de ce monde quelles qu’elles soient, et en tout temps, doivent céder le pas et faire place à une réunion prolongée. Mais les affaires de ce monde, quand ce sont des devoirs, ne sont pas nos affaires : ce sont les affaires de Dieu, tout autant que nos devoirs religieux, nos prières et nos réunions prolongées. Celui qui ne considère pas ses affaires sous ce point de vue n’a pas encore pris sa première leçon de religion, n’a pas appris à faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Avec une telle vue de ce sujet, séparant nos affaires d’avec la religion, nous vivrions six jours pour nous-mêmes, et le septième pour le Seigneur !
Les devoirs réels ne se contredisent jamais l’un l’autre.
Les jours ouvriers ont leurs devoirs respectifs ; et les Dimanches ont aussi les leurs, et nous devons être également pieux tous les jours de la semaine et dans l’accomplissement de nos devoirs de chaque jour. Nous devons labourer, semer, vendre, en un mot, exercer chacun sa profession en vue de la gloire de Dieu avec autant de sincérité et de franchise que nous en mettons à nous rendre tous les Dimanches à l’église, à prier dans nos familles et à lire nos Bibles.
C’est là un principe fondamental de la religion. Celui qui ne connaît pas ce principe et n’agit pas en conséquence n’a pas appris jusqu’à présent l’A.B.C. de la piété. Or, il y a dans l’année des moments où Dieu, dans sa providence, appelle l’homme, tout particulièrement, à s’occuper des affaires de ce monde, parce que, dans ces moments, ces affaires sont particulièrement pressantes, et qu’elles doivent être faites dans ce temps-là ou jamais ; pour le laboureur c’est le temps des semailles et celui de la moisson ; pour le marchand ce sont certaines autres époques. Et nous n’avons aucun droit de dire, dans ces moments-là, que nous voulons laisser nos affaires à nous, et établir une réunion prolongée, parce que ces affaires ne sont pas les nôtres.
Et à moins que Dieu, par quelque signe spécial de sa Providence, ne nous montre qu’il veut nous voir négliger ces affaires et tenir une réunion prolongée dans ces temps d’occupation, ce serait tenter Dieu que de les établir. « Ô Dieu, dit-on quelquefois, ces affaires du monde sont nos affaires, et nous voulons les mettre de côté pour nous occuper des tiennes ! » Mais si Dieu n’a pas fait voir clairement que c’est son bon plaisir de répandre son Esprit et de donner une nouvelle vie à son œuvre dans ces moments-là, et qu’il a ainsi appelé les hommes à quitter pour le moment actuel leurs occupations ordinaires, et à tenir une réunion prolongée, il me semble qu’il pourrait alors nous dire dans ces circonstances : « Qui a requis cela, de vos mains ? »
Sans doute, Dieu a le droit de disposer de notre temps comme il lui plaît ; et il peut exiger de nous que nous donnions une partie de ce temps ou tout notre temps aux devoirs de l’instruction et de la dévotion ; et quand les circonstances nous y appellent clairement, c’est alors notre devoir de laisser là toute autre occupation, et de faire pour le salut des âmes des efforts soutenus et continuels. Si nous conduisons nos affaires, mus par de justes motifs, basés sur des principes droits, et en vue de la gloire de Dieu, nous ne refuserons jamais de les quitter pour tenir des réunions prolongées, toutes les fois que la Providence de Dieu nous en manifestera le besoin.
Un homme qui ne se considère que comme un intendant ou un commis ne regardera pas comme une peine, mais bien comme un privilège, de se reposer le Dimanche des travaux de la semaine. Le propriétaire égoïste peut n’avoir aucune envie de suspendre ses travaux le Dimanche ; mais le commis qui travaille, non pour lui-même, mais pour celui qui l’emploie, considère comme un privilège de pouvoir se reposer ce jour-là. De même, si nous travaillons en vue de Dieu, nous ne regarderons pas comme une chose dure le devoir qu’ils nous imposera de suspendre le cours de nos affaires terrestres et de nous rendre à une réunion prolongée ; nous la regarderons au contraire comme un jour saint.
Toutes les fois donc que vous entendrez une personne dire que ses affaires ne lui permettent pas d’aller à une réunion prolongée, que c’est son devoir de s’occuper de ses affaires, vous aurez sujet de craindre qu’elle ne regarde ses affaires comme les siennes propres, et les réunions comme l’affaire de Dieu. Si elle sentait que ce qui concerne les magasins et les métairies est aussi bien l’affaire de Dieu que les réunions, elle serait sans aucun doute, dans la plupart des cas, très disposée à se reposer des travaux de la vie, et à se rendre dans la maison de Dieu pour y rafraîchir son âme, à s’y rendre, dirai-je encore, toutes les fois que Dieu aurait montré en quelque manière que la communauté y était appelée ; car il est extrêmement remarquable que les fêtes des Juifs avaient lieu aux époques de l’année où les affaires indispensables de ce monde étaient le moins pressantes.
On a vu des cas où des réunions ont été établies aux moments les plus défavorables, dans les jours de grande presse ; et où elles n’ont aussi été suivies d’aucun bon résultat, évidemment parce que l’on n’avait pas fait attention à la règle ci-dessus mentionnée. Il est vrai qu’en certains autres cas, ces réunions se sont tenues dans des moments où les affaires de ce monde étaient pressantes, et ont été couronnées de bénédictions signalées ; mais alors la bénédiction provenait de ce que ces réunions avaient été établies par obéissance à quelques indications de la volonté de Dieu, indications que reconnurent ceux qui avaient du discernement spirituel et qui comprenaient les signes des temps. Souvent, sans doute, tels individus y ont assisté, en supposant qu’ils abandonnaient leurs propres affaires pour s’occuper de celles de Dieu ; dans ces cas-là, ils faisaient ce qu’ils estimaient être un sacrifice réel ; et Dieu, dans sa miséricorde, leur accordait sa bénédiction.
b. Ordinairement une réunion prolongée devrait être conduite d’un bout à l’autre par le même ministre. Quelquefois elles ont dépendu de ministres qui arrivaient les uns après les autres, et elles n’ont été suivies d’aucune bénédiction. La raison en est claire. Ces ministres ne venaient pas dans l’esprit que l’œuvre demandait, ils ne connaissaient pas l’état des âmes ; et ils ne savaient, en conséquence, pas que prêcher. Supposez qu’une personne malade prenne chaque jour un autre médecin. Celui-ci ne sera pas au fait des symptômes qui se sont manifestés précédemment, ni du cours qu’a pris la maladie, ni des traitements qui ont été suivis, ni des remèdes qu’on a donnés, ni de ce que pourrait supporter le patient ; et il tuera le malade. Il en est exactement de même pour une réunion prolongée, tenue tantôt par un ministre, tantôt par un autre. Aucun d’eux ne saura entrer dans l’esprit de ces réunions, qui généralement feront alors plus de mal que de bien.
Ordinairement ces réunions ne devraient être annoncées que lorsqu’on sera bien assuré des moyens de les soutenir, et d’un ou deux ministres qui s’accorderont à les conduire jusqu’à la fin. Alors on pourra compter sur une riche bénédiction.
c. Les réunions publiques ne devraient pas être nombreuses au point de faire négliger les devoirs de la prière secrète et ceux de la famille. Autrement les chrétiens perdront leur spiritualité, cesseront de s’attacher à Dieu, et par là même assureront la ruine de ces réunions.
d. Les familles ne devraient pas s’occuper des étrangers qu’elles reçoivent au point de négliger la prière et autres devoirs. Il arrive souvent que, lors d’une réunion prolongée, telle des principales familles de l’Église, j’entends celles sur lesquelles on se repose le plus pour le soutien de la chose, n’entre pas du tout dans l’œuvre. La raison en est qu’elle est souvent tout occupée à servir les étrangers qui viennent de tous côtés se rendre à la réunion, et à les traiter quelquefois avec une grande somptuosité. Une chose devrait être toujours bien comprise dans ces cas : c’est que le devoir des familles est d’avoir le moins d’ouvrage et d’étalage que possible, de se livrer à l’hospitalité de la manière là moins assujettissante, pour avoir le temps de se rendre de son côté à la réunion, de prier et de s’occuper des affaires du royaume de Dieu.
e. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que ces réunions ne se tiennent pas sans nécessité à une heure avancée. Si, une nuit après l’autre, l’heure de la réunion est trop avancée, le corps ne tardera pas à s’épuiser ; la santé des assistants s’altérera, et une réaction aura lieu. On se laisse quelquefois aller à l’excitation au point de perdre le sommeil ; on met de l’irrégularité dans les repas, jusqu’à ce qu’on soit brisé. A moins que l’on prenne le plus grand soin de conserver de la régularité, l’excitation pourra devenir si grande, que la nature n’y tiendra plus et que l’œuvre s’arrêtera.
f. Tout esprit, de secte doit être évité, soit dans la prédication, soit dans la prière, soit dans la conversation. Il neutraliserait tout le bien que la réunion pourrait faire.
g. Soyez vigilants à ne pas vous reposer sur une réunion prolongée, comme si elle pouvait d’elle-même produire un réveil. Ceci est un grand écueil, et l’a toujours été. C’est la principale raison pour laquelle l’Église a toujours été obligée, de génération en génération, d’abandonner les mesures qu’elle avait prises pendant quelque temps, parce que les chrétiens en étaient venus à se reposer sur elle pour le succès. Il en a été ainsi en divers endroits pour ce qui regarde les réunions prolongées. Elles ont été tellement bénies, que les hommes se flattaient de voir les pécheurs convertis et de recevoir de grandes bénédictions dès qu’ils pourraient avoir une réunion de ce genre. Et alors ils en établissaient une, lorsque l’Église ne s’y était nullement préparée ; et ils faisaient venir de l’étranger quelque ministre de distinction, qu’ils invitaient à prêcher, comme si cela devait convertir les pécheurs. Il est clair que la bénédiction ne pouvait reposer sur une réunion établie de cette manière-là
h. Gardez-vous de croire qu’un réveil ne saurait avoir lieu sans une réunion prolongée. Quelques églises ont eu à ce sujet des sentiments qui leur ont fait beaucoup de mal ; leur zèle est devenu spasmodique et fiévreux ; elles pensaient ne pouvoir produire de réveil que de cette manière.
Lorsqu’une réunion prolongée avait lieu, elles paraissaient merveilleusement zélées ; puis, elles retombaient dans un état de torpeur, jusqu’à ce qu’une autre réunion prolongée revînt produire une autre secousse. Maintenant des multitudes dans l’Église croient nécessaire d’abandonner ces réunions, parce qu’elles ont donné lieu à des abus. Mais cela encore est un abus, toute église doit se garder soigneusement de renoncer à ces réunions, de peur de perdre tout le bien qu’elles sont destinées à produire.
3. Le banc des âmes travaillées.
J’entends par là un banc réservé, dans le lieu de la réunion, sur lequel viennent s’asseoir les âmes troublées, auxquelles on s’adresse alors particulièrement, qui sont un sujet de prière, et avec lesquelles on converse quelquefois individuellement. De tout temps cette mesure a rencontré une opposition plus vive qu’aucune autre. Et cependant quelle objection fondée peut-on y faire ? Je ne saurais la voir. Le but du banc des angoissés est indubitablement philosophique et conforme aux lois de l’esprit : ce but est double.
1° Lorsqu’une personne est sérieusement troublée dans son âme, chacun sait qu’il y a en elle un penchant extrême à cacher son état aux yeux des hommes ; et qu’on a beaucoup gagné sur elle une fois qu’on est parvenu à la faire consentir à ce que son état soit connu des autres. Quand une personne est écrasée du sentiment de sa misère, et que vous pouvez obtenir qu’elle consente à ce que son état soit connu, en l’amenant ainsi à briser les chaînes de l’orgueil, vous lui avez fait faire un pas immense vers la conversion. Ceci est parfaitement d’accord avec la philosophie de l’esprit humain. Combien de milliers d’âmes n’y aura-t-il pas qui béniront Dieu pendant toute l’éternité, de ce que, pressées par la vérité, elles se sont vues obligées de faire le pas dont il s’agit, en rejetant l’idée que c’était une chose terrible de faire connaître à qui que ce fût qu’elles étaient sérieusement occupées de leurs âmes.
2° Un autre but qu’on se propose en réservant aux âmes angoissées une place particulière, c’est de dissiper les illusions et de prévenir ainsi de fausses espérances. On s’est opposé à cette mesure en alléguant qu’elle était propre à créer des illusions et des espérances vaines. Mais cette objection est déraisonnable ; et elle convient parfaitement à la manière d’agir opposée. Je prêcherais, je suppose sur la tempérance ; je montrerais les maux occasionnés par l’intempérance ; je dépeindrais un ivrogne avec sa famille, et je parlerais sur les malheurs que ce vice traîne à sa suite, jusqu’à ce que tous les cœurs palpitassent d’émotion.
Je dépeindrais alors le grand danger qu’il y a, pour un homme plongé dans ce vice, à boire même modérément, comment cette demi-mesure le ramènera à l’ivrognerie et à la ruine ; et je montrerais qu’il n’y a pour lui de sûreté que dans une abstinence totale, jusqu’à ce qu’une centaine d’auditeurs soient prêts à dire : « Je ne veux plus jamais boire une seule goutte de liqueur ; car, si je le fais, je ne puis attendre autre chose que le tombeau de l’ivrogne ». Je m’arrête alors, et je fais circuler un engagement par lequel on prend la résolution de ne plus boire de spiritueux du tout, et que doivent signer tous ceux qui veulent fermement prendre ce parti.
Combien n’y en aura-t il pas alors qui reculeront et qui hésiteront quand vous les appellerez à signer l’engagement : « Faut-il signer ou non ? Je croyais avoir bien pris mon parti ; mais signer l’engagement de ne plus boire jamais, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire ! » Vous voyez ainsi que lorsqu’une personne est appelée à signer un engagement, si elle est encore indécise, elle prouve clairement par un refus palpable, qu’elle n’était pas sincère, c’est-à dire que ses résolutions n’ont jamais été assez fortes pour pouvoir influer sur sa vie future. Il en est souvent de même du pécheur qui se croit réveillé.
Prêchez ; et aussitôt il se croira prêt à faire quelque chose, et déterminé à suivre le Seigneur. Mais mettez-le à l’épreuve, appelez-le à faire un pas qui l’identifie avec le peuple de Dieu ou qui crucifie son orgueil, aussitôt son orgueil s’élève et il refuse ; ses illusions sont dissipées, et il se trouve encore comme auparavant, un pécheur perdu ; au lieu que si vous ne l’aviez pas mis à l’épreuve, il s’en serait peut-être allé se flattant lui-même d’être chrétien. Dites-lui donc : « Voilà le banc des âmes travaillées ; venez et confessez devant les hommes que vous êtes déterminé à vous ranger du côté de l’Éternel ». Si le pécheur n’est pas disposé à faire une chose si facile, il ne veut rien faire du tout ; et sa propre conscience lui montre alors ce qui est.
Cette manière d’agir découvre donc la tromperie du cœur humain, et prévient une quantité de fausses conversions en manifestant d’une manière matérielle ceux qui, sans cela, pourraient s’imaginer être disposés à faire quelque chose pour Christ, tandis que dans le fait ils ne veulent rien faire du tout.
De tous temps l’Église a senti la nécessité d’avoir une épreuve, un acte de ce genre pour atteindre directement ce but. Aux jours des apôtres c’était le baptême. L’Évangile était annoncé au peuple ; puis l’on faisait venir, pour les baptiser visiblement, tous ceux qui voulaient être du côté de Christ. Cette cérémonie remplissait précisément l’un des offices du banc des âmes travaillées ; c’était une manifestation publique de la ferme résolution qu’ils prenaient d’être chrétiens. Et dans les temps modernes, ceux qui ont repoussé l’usage du banc dont nous parlons ont été obligés de lui chercher quelque équivalent, sous peine de renoncer à tout réveil.
Il y en a, par exemple, qui ont invité les personnes travaillées à rester après que la congrégation se serait retirée. Mais où est la différence entre les deux pratiques ? Dans les deux cas l’épreuve est la même. D’autres ont fait venir les âmes angoissées dans une chambre spéciale. Mais leur objet est toujours le même, et leur principe aussi : C’est de dépouiller les pécheurs de la fausse honte derrière laquelle ils se réfugient.
J’ai entendu parler d’un homme qui était allé bien loin dans son opposition aux nouvelles mesures, et qui, dans une réunion qu’il présidait, demanda que tous ceux qui étaient résolus à se soumettre à Dieu, ou qui désireraient qu’on priât pour eux, le fissent savoir en inclinant leur tête en avant sur le banc qui était devant eux. Qui ne voit que c’est là un pur déguisement du banc des âmes travaillées, que le but de cette formalité était le même, et que ce ministre sentait bien l’importance d’une mesure de ce genre ? Ainsi donc, quelle objection fait-on à ces diverses mesures ?
Elles n’ont toutes qu’un même but ; et en principe elles ne sont même nullement des nouveautés. Pour le fond, la chose a toujours été faite ; aux jours de Josué, ce général somma le peuple de se décider pour ce qu’ils feraient, et ils répondirent ouvertement dans l’assemblée : « Nous servirons l’Éternel ; l’Éternel notre Dieu est celui que nous servirons et à la voix duquel nous obéirons (Josué 24 v. 24) ».
Remarques additionnelles.
1. Si nous parcourons l’histoire de l’Église, nous trouverons qu’il n’y a jamais eu de réformation étendue que par des innovations. Toutes les fois que les églises s’établissent dans quelque forme d’action, elles en viennent bientôt à se reposer sur l’extérieur et à ne retenir que la forme de la religion en en perdant la force et la substance. Et alors on n’a jamais pu les exciter, les réveiller, ou y produire un réveil en suivant simplement la forme établie ; et ce ne serait peut-être pas trop de dire qu’il est impossible à Dieu lui-même de faire une réformation sans employer de nouvelles mesures.
Du moins, c’est un fait constaté que Dieu a toujours choisi ce moyen comme étant le plus sage et le meilleur qu’il pût adopter. Et quoique les mesures que Dieu lui-même a employées et bénies pour donner une nouvelle vie à son œuvre aient toujours été dénoncées comme des mesures nouvelles, qu’elles aient toujours trouvé, en conséquence, de l’opposition, cependant Dieu continue d’agir par le même principe. Lorsqu’il voit que tel moyen a perdu de son efficace en ne devenant plus qu’une vaine forme, il amène une nouvelle mesure qui fait violence aux habitudes de paresse, et qui réveille l’Église assoupie. Il en résulte donc toujours un grand bien.
2. Les mêmes distinctions qui existent actuellement ont toujours existé sous une forme ou sous l’autre dans tous les temps de réformation et de réveil. Il s’est toujours trouvé des personnes qui étaient particulièrement attachées à leurs formes et à leurs idées, et qui, dans le moindre de leurs moyens d’agir, prétendaient n’agir qu’en vertu d’eux. « Ainsi dit l’Éternel. » Puis ils donnaient à ceux qui avaient une opinion différente de la leur, et qui s’efforçaient de pousser en avant l’arche du salut, les noms de méthodistes, de nouvelles lumières, de radicaux, de nouvelle école, de nouvelle théologie et différents autres noms injurieux. Le relâchement qui a été la suite d’un pareil principe d’immobilité est dû uniformément à deux causes sur lesquelles l’Église ne devrait point passer avec légèreté.
1° La vieille école, ou le parti des anciennes mesures, a persévéré dans son opposition, et s’est avidement emparée de quelques indiscrétions, réelles ou apparentes, des amis du réveil.
Dans ces cas, les églises qui ont voulu chercher la vie ont graduellement abandonné leur opposition aux nouvelles mesures ; et les cris de « théologie nouvelle et d’innovation » ont cessé de les alarmer. Elles voient la bénédiction de Dieu reposer sur ceux qui sont traités de novateurs ; et l’opposition incessante de la vieille école, jointe aux succès constants de la nouvelle, ont fait évanouir chez elle les préjugés. En sorte que la balance a fini par pencher de l’autre côté, et que les églises ont prononcé un verdict de condamnation sur la vieille école, et se sont déclarées pour la nouvelle.
2° Mais remarquez maintenant ce qui arriva. Le diable a profité de cette oscillation ; des individus se sont levés, qui, voyant les églises dégoûtées de l’opposition et disposées à faire quelque chose pour le royaume de Christ, se sont jetées à l’étourdie dans l’œuvre nouvelle, et ont ainsi entraîné les églises dans le gouffre même des difficultés que les opposants avaient signalées. Ainsi, quand le combat s’est engagé et que la victoire a été remportée, le zèle inconsidéré de quelques individus bien intentionnés, mais étourdis, a amené une réaction qui a recouvert l’Église comme d’un linceul durant plusieurs années. Tel a été le cas, personne ne l’ignore, aux jours du président Edwards.
Or, voilà un écueil sur lequel on a maintenant construit un phare ; et si l’Église vient à y échouer, les deux partis seront également inexcusables. On sait, ou on devrait maintenant savoir parfaitement, que la décadence qui suivit ces jours de réveil, et qui s’est depuis lors manifestée à plusieurs reprises, est due à la combinaison de l’influence de l’opposition persévérante et opiniâtre de la vieille école et à la négligence ou au mauvais esprit de quelques-uns des membres de la nouvelle.
Voilà donc où il faudrait sonner l’alarme pour les deux partis, de peur que le diable ne gagnât de nouveau la bataille sur un point et dans des circonstances où il a si souvent déjà eu l’avantage.
L’Église ne recevra-t-elle donc jamais instruction de l’expérience ? Combien de fois, oh ! combien de fois faudra-t-il que ces scènes se passent avant que le règne de Dieu arrive effectivement dans sa gloire ? Quand viendra l’heureux jour où l’Église pourra recevoir une nouvelle vie et voir fleurir la religion dans son sein, sans qu’on ait l’a douleur de voir se réveiller, dans l’Église même, une opposition si grande, qu’elle amène éventuellement une réaction !
3° Le cri qu’on élève de nos jours contre les nouvelles mesures est souverainement ridicule, quand on considère d’où il vient et dans quelles circonstances. On est stupéfait de voir des ministres graves s’alarmer réellement des nouvelles mesures d’aujourd’hui, comme si elles étaient quelque chose de nouveau sous le soleil, et comme si les formes où ils se trouvent enveloppés, ainsi que leurs moyens d’action, descendaient en droite ligne des apôtres, ou venaient de la bouche même de l’Éternel ; tandis que chacun des pas que l’Église a faits hors des profondes ténèbres du papisme, n’est dû qu’à l’introduction d’une innovation après une autre.
Nous voyons maintenant avec étonnement, je dirais presque avec mépris, les cris « d’innovation » qui se sont fait entendre dans le siècle précédent ; et lorsque nous passons en revue les craintes qu’une multitude dans l’Église entretenaient, il n’y a que peu de temps encore, au sujet de certaines innovations, maintenant admises, nous ne savons comment qualifier les objections et les difficultés sans fondements, absurdes ou ridicules, qu’on s’efforçait d’y trouver.
N’est-il donc pas étonnant que de nos jours, après l’expérience tant de fois répétée que l’Église a faite à ce sujet, il se trouve des hommes graves et pieux qui soient sérieusement alarmés de l’introduction des mesures simples, philosophiques et prospères des dix dernières années ? Comme si les nouvelles mesures avaient en elles-mêmes quelque chose d’intolérable, qui eût une tendance désastreuse et qui dût faire retentir dans tous les coins et recoins de l’Église les sons et les échos de la cloche d’alarme !
4° Nous voyons maintenant comment il se fait que ceux qui se sont tant élevés contre les nouvelles mesures n’aient pas eu de succès dans leurs efforts pour produire un réveil.
Ils ne se sont occupés que des maux, réels ou imaginaires, qui accompagnaient cette œuvre si grande et si évidemment bénie de Dieu. Certainement il s’y est mêlé du mal, personne ne le nie.
Mais je crois que, depuis le commencement du monde, aucun réveil n’a été accompagné de moins de mal que celui qui a éclaté avec tant de puissance et d’extension dans les dix dernières années.
Et cependant une grande portion de l’Église a pris l’alarme et l’a communiquée aux autres, en donnant une attention permanente et exclusive aux maux qui peuvent éventuellement résulter des réveils. Un des professeurs d’une école de théologie presbytérienne crut de son devoir d’adresser aux presbytériens une série de lettres, qui circulèrent à de grandes distances, et dont l’objet semblait être de donner l’alarme jusqu’aux extrémités de l’Église, pour qu’on prît garde aux maux qui résulteraient d’un réveil.
Or, quand, au lieu de regarder à l’excellence d’une œuvre bénie de Dieu, les hommes ne jettent les yeux que sur le mal qui pourrait s’y mêler ou en découler, comment peut-on s’attendre à ce que ces mêmes hommes puissent être de quelque utilité pour l’avancer ? Je veux n’en parler qu’avec charité ; mais c’est encore un point sur lequel je ne saurais me taire.
5° Sans nouvelles mesures il est impossible que l’Église réussisse à porter l’attention du monde sur la religion. Il y a tant de sujets excitants qui passent devant les yeux des hommes, I tant de mouvement, tant de cris « Venez ici », et « Venez là ! » Que l’Église ne saurait rivaliser avec le monde si elle n’a pas de prédications vivantes et des mesures assez nouvelles pour obtenir l’attention publique.
Les mesures des politiques, des incrédules, des hérétiques, l’acharnement après les richesses, les progrès croissants du luxe et les mille et une influences contraires qui agissent sur l’Église et sur le monde, captiveront l’attention des hommes et les détourneront des autels et du sanctuaire de l’Éternel, à moins que nous ne croissions en sagesse et en piété, et n’adoptions prudemment telle ou telle nouvelle mesure calculée pour rendre les hommes attentifs à l’Évangile de Christ. J’ai déjà dit, dans un de mes discours précédents, que les innovations ne doivent pas être introduites plus tôt qu’il ne le faut réellement, et qu’on doit alors le faire de manière à causer le moins d’opposition possible, avec la plus grande sagesse et précaution, et dans un esprit de prière.
Mais il nous en faut des innovations. Et que Dieu préserve l’Église de s’établir dans des formes quelconques, ou de stéréotyper ses mesures actuelles, ou quelque autre forme que ce soit !
6° Il est évident que nous devons avoir une prédication plus vivante qu’elle ne l’était jusqu’ici, qui puisse satisfaire aux besoins et répondre au caractère de l’époque où nous vivons. Les ministres commencent généralement à le sentir, quelques-uns même vont jusqu’à s’en plaindre, en disant qu’on est redevable de ce besoin aux nouvelles mesures, comme ils les appellent. « Des ministres », disent-ils, « que nos pères eussent été heureux d’entendre, ne trouvent maintenant aucun accès, et ne savent où aller pour trouver un auditoire qui les reçoive ! » Et ils pensent que les nouvelles mesures ont perverti le goût du peuple. Mais ce n’est pas là qu’est le mal. Le caractère de notre siècle est changé, et les hommes qui se plaignent ne s’y sont pas conformés, mais ils ont retenu cette manière de prêcher tendue, sèche, raide et ampoulée qui était en usage il y a un demi-siècle.
Voyez, au contraire, les méthodistes. Plusieurs de leurs ministres sont ignorants, dans le sens ordinaire de ce mot ; beaucoup d’entre eux sont sortis directement des boutiques ou des fermes, et cependant ils ont fondé des réunions, fait leur chemin au milieu des obstacles et gagné des âmes partout où ils allaient. Peu de ministres presbytériens ont amené à Jésus autant d’âmes ou fondé des réunions aussi nombreuses que les méthodistes ; leur prédication simple, claire, incisive, mais chaude et vivante, attire toujours une foule d’auditeurs.
Or, parmi tous ces changements qui ont lieu autour de nous, nous laisserons-nous persuader que notre devoir est de nous conformer à une vieille routine ? Les eaux des fleuves remonteraient plutôt à leur source, que le monde ne serait converti par une telle prédication ; et nous verrions les hommes s’éloigner de nous pour s’attacher à ceux qui adopteront, comme les méthodistes l’ont fait, une manière de prêcher plus en rapport avec les besoins de l’époque. Certainement le monde ne tardera pas à échapper à l’influence de cette prédication à la vieille mode, ou plutôt à la moderne.
Il est impossible, je le répète, que l’esprit public puisse être captivé par une prédication sans naturel. Il nous faut une prédication puissante, vivante ; autrement le diable aura tous les hommes, excepté ceux que les méthodistes pourront sauver. Il n’est pas possible que nos ministres continuent à faire du bien s’ils ne se soumettent à introduire des innovations dans leur manière de prêcher. Beaucoup d’entre eux s’aperçoivent déjà qu’un prédicateur simple mais ardent, sans avoir l’avantage d’une éducation libérale, se formera un auditoire plus nombreux qu’un ministre prêcheur ne le saurait faire, parce qu’il n’a pas, tant s’en faut, l’ardeur de l’autre et ne répand aucun feu sur ses auditeurs lorsqu’il les sermonne.
7. Nous voyons de quelle importance il est que nos jeunes ministres aient des vues claires et justes sur les réveils. Dans une foule de cas j’ai vu qu’on s’efforçait d’effrayer nos jeunes gens qui se préparaient pour le ministère, au sujet des réveils, des innovations et d’autres choses semblables. Dans quelques écoles de théologie on enseigne même aux jeunes gens à regarder les nouvelles mesures comme si c’étaient autant d’inventions du diable.
Comment, sur ce pied-là, pourraient-ils avoir des réveils ? Dès qu’ils entrent en fonctions, ils ont l’œil au guet, ils veillent et tressaillent, comme s’ils voyaient tous les maux de l’enfer. Il n’y a que peu d’années, quelques jeunes gens sortirent de Princeton avec un Essai sur le « danger des réveils ». Or, je serais curieux de savoir combien d’entre eux ont eu des réveils dans leurs troupeaux, depuis qu’ils sont entrés dans le ministère ; et s’ils en ont eu, je voudrais bien savoir s’ils maintiennent toujours les principes de cet écrit sur les dangers des réveils.
Si ma voix pouvait arriver jusqu’à Princeton, je leur parlerais, je voudrais y faire entendre de sérieux avertissements sur ce sujet ; car il est grand temps qu’il soit convenablement connu. De toutes les extrémités de l’Église des gémissements se font entendre sur le manque de ministres convenables. Des hommes pieux travaillent et désirent travailler jour et nuit pour les jeunes gens qui se préparent au saint ministère, afin qu’ils puissent produire des réveils ; et quand ces jeunes gens sortent du séminaire, il y en a qui redoutent les mesures les plus bénies de Dieu, aussi vivement qu’ils redoutent le papisme lui-même.
En sera-t il toujours ainsi ? élèverons-nous des jeunes gens pour le ministère afin de les voir sortir des études ennemis de toute innovation, comme si pareille chose ne s’était jamais vue ? Laissez-les se mettre à l’œuvre eux-mêmes, et ne leur inspirez pas ces vaines terreurs. J’ai vu avec peine des hommes qui, en rendant compte de certains réveils, ont jugé indispensable d’entrer dans le détail des mesures qui avaient été employées pour montrer qu’elles n’étaient pas nouvelles ; ils croyaient probablement que l’Église mépriserait un réveil, s’il eût été entaché de nouvelles mesures.
Mais je crains bien qu’avec ces préjugés il ne se soit déjà fait beaucoup de mal, et si cela continue on en viendra à juger d’un réveil par le seul fait qu’il ait eu lieu, ou non, par suite de mesures nouvelles ou de mesures anciennes. Jamais je ne saurais approuver un pareil esprit, ni consentir à une règle semblable ; car ce n’est pas faire une objection raisonnable à une mesure quelconque, que de dire qu’elle est ancienne ou nouvelle.
Que le ministre entre donc pleinement dans son œuvre ; qu’il répande son cœur en la présence de Dieu pour obtenir sa bénédiction, et qu’il adopte sans crainte toute mesure qu’il jugera nécessaire pour présenter la vérité avec plus de puissance à ses auditeurs. Dieu ne lui retiendra pas sa grâce. Mais les ministres qui ne voudront pas aller en avant et prêcher avec force et ardeur ; ceux qui resteront dans leur ornière, refusant de rien faire de nouveau pour le salut des âmes, ceux-là contristeront le Saint-Esprit, Dieu les visitera de sa malédiction ; et il suscitera d’autres ministres pour travailler dans le monde.
8. D’après tout ce que nous venons de dire, c’est donc le droit et le devoir des ministres d’adopter de nouvelles mesures pour produire un réveil. Dans quelques endroits tel ministre, qui avait essayé de ces mesures bénies de Dieu pour les réveils, s’est vu combattu par sa propre église, qui en est même venue jusqu’à abandonner les réunions de prière, à abandonner le travail pour le salut des âmes, enfin à se tenir à l’écart, dans une complète inactivité, par la raison que son ministre avait adopté ce qu’elle appelait de nouvelles mesures. Peu importe la sagesse, l’à-propos d’une chose en elle-même, ou la bénédiction que Dieu peut y faire reposer ; il suffit qu’elle soit nouvelle mesure ; on ne veut pas en entendre parler. C’est ainsi qu’on tombe, que l’on contriste le Saint-Esprit, et qu’on met obstacle à tout réveil, tandis que le monde se précipite en enfer !
Finalement. On attachement passionné à des formes ou à des moyens d’agir particuliers, cet attachement qui porte l’Église à résister aux innovations dans les mesures à employer, cette disposition sent fortement le fanatisme. Et ce qui est assez singulier, c’est que les fanatiques de cette trempe sont toujours les premiers à crier au « fanatisme ». Or, qu’est-ce, dans l’Église romaine, autre chose que du fanatisme, qui la fait adhérer avec une telle opiniâtreté à ses coutumes, à ses formes, à ses cérémonies et à ses folies ? Les papistes s’imaginent que toutes ces choses sont d’autorité divine, que pour chacune d’elles il y a un « Ainsi a dit l’Éternel ».
Or, si nous appelons avec raison cet esprit, un esprit de fanatisme ; et si nous le regardons comme très blâmable, il est tout aussi fanatique de la part de l’Église presbytérienne ou de toute autre, de tenir avec acharnement à des formes particulières et d’agir comme si ces formes-là étaient d’institution divine. Le fait est que Dieu n’a établi aucune espèce de formes particulières destinées à régler le culte et à avancer les intérêts de la religion. Sous la dispensation évangélique, les Écritures gardent le plus profond silence sur ces points-là, qui sont entièrement laissés à la discrétion de l’Église. C’est pourquoi j’espère qu’on ne m’accusera pas de manquer de charité, si je répète que le zèle amer et irritable qu’on apporte souvent à ces questions, que les cris outrageants et exterminateurs que l’on élève contre les nouvelles mesures sentent fortement le fanatisme.
La seule chose sur laquelle la dispensation évangélique insiste dans ces matières, c’est qu’on y mette de l’ordre et de la bienséance. « Que toutes choses se fassent avec ordre et avec bienséance (1 Corinthiens 14 v. 40). Mais qu’est-ce que la bienséance, et qu’est-ce que l’ordre ? Prétendra-t-on qu’une réunion pour les pécheurs angoissés, qu’une assemblée prolongée, qu’un banc réservé aux âmes travaillées, sont incompatibles avec l’ordre et la bienséance ? Je m’élèverai sincèrement et avec force contre tout ce qui serait malséant et désordonné dans le culte qu’il faut rendre à Dieu dans sa maison. Mais je ne dis pas que par « ordre » il nous faille entendre un mode particulier dans lequel l’Église aurait été accoutumée à servir Dieu.
 Un message de Charles Finney
Un message de Charles Finney
© Reproduction gratuite autorisée en indiquant l'auteur et la source bible-foi.com.