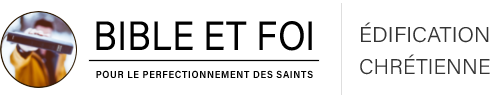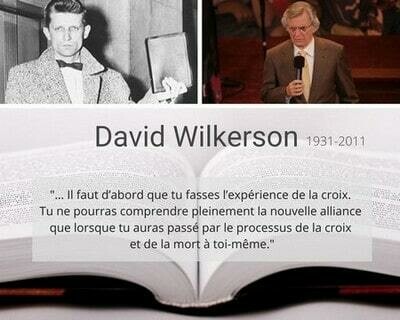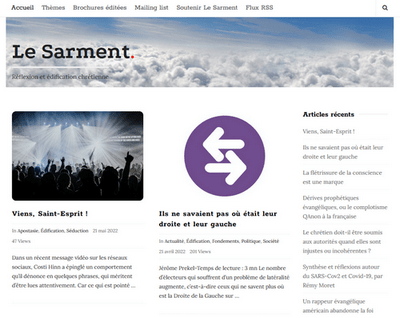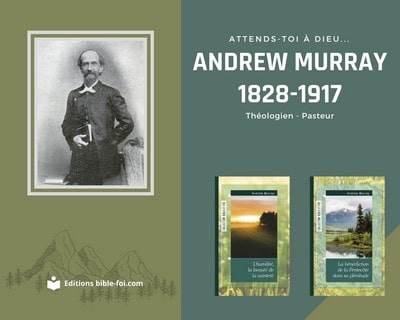Dieu dans Son essence et Ses attributs
Les attributs peuvent être une conséquence nécessaire de ce que Dieu est, et qui, je suppose, en Dieu est toujours ; mais ils ne sont pas ce qu’il est Lui-même.
Distinction entre Être et attributs.
Ce qui est fondamental quand nous parlons d’Attributs est inhérent au terme lui-même. Les attributs ne sont pas l’être, dans sa nature essentielle (quand même on les y trouve toujours), mais bien ce qui est attribué avec raison à l’être comme tel. Cette distinction qui n’est pas sans importance, en parlant de Dieu, est bien simple en elle-même. Les attributs sont relatifs ; or Dieu étant absolu, on ne peut dire qu’il soit l’attribut lui-même. L’attribut n’est qu’un des caractères qui lui sont propres. Dieu est quelque chose en lui-même ; mais il est aussi quelque chose relativement à d’autres choses, quand elles existent ou sont supposées exister.
Absolue suprématie de Dieu, même par rapport à la conscience.
De plus, on ne peut, justement, approprier à Dieu aucun attribut qui lui ôterait, comme Dieu, sa place de nécessaire et absolue suprématie. L’être auquel je supposerais un tel attribut cesserait d’être Dieu. Dieu ne peut être un objet de jugement, ou autrement il a entièrement perdu sa place comme Dieu ; et certes, celui qui juge Dieu usurpe sa place et le déclare son inférieur : Dieu dès lors ne serait évidemment plus Dieu. Cicéron dit, dans le « De Officiis » : « Quasi materia… subjecta est veritas » (*).
Or il est évident que jamais Dieu ne peut être cela, c’est-à-dire la vérité, comme l’entend le philosophe ; car alors mon esprit serait suprême, et Dieu lui serait assujetti. Une telle pensée est à la fois l’orgueil et la folie de l’homme. C’est ce que le rationalisme moderne (et aussi, je le suppose, l’esprit humain dans tous les temps) appelle la suprématie de la conscience, par laquelle l’homme juge de la révélation et de tout le reste. Mais si la conscience, — en tant que mon action et mon jugement, est suprême, il n’y a point de Dieu du tout. Un Dieu qui n’est pas seul suprême est un « Lo-El » ; « pas Dieu ».
* « Ainsi que la matière… la vérité nous est assujettie ».
La conscience.
L’homme n’a-t-il donc aucune pensée quelconque quant à Dieu ? Bien au contraire. L’homme ne peut juger par son esprit, il est vrai, mais il a la connaissance du bien et du mal, la conscience. Elle peut être corrompue, pervertie, endurcie,… cependant l’homme fait la différence entre le bien et le mal. L’Écriture nous montre que cela, l’homme l’a acquis par la chute, et ainsi comme étant sous le péché. Toutefois la conscience introduit Dieu, car il dit : « Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour connaître le bien et le mal (Genèse 3 v. 22) ». La conscience n’est pas une loi ou une règle, venant du dehors, imposée à l’homme ; mais elle est ce qui est intrinsèque dans l’homme : l’homme dit : Ceci est bien, cela est mal, et il conclut immédiatement que Dieu ne peut approuver une chose mauvaise, ni condamner une chose bonne.
L’homme peut avoir, il est vrai, par suite de ses passions, de son éducation, de ses habitudes, une mesure très fausse du juste et de l’injuste ; les démons aussi, dont il a fait ses dieux, peuvent lui faire appeler le mal bien, et le bien mal ; mais il fait la différence, et le sentiment même du bien et du mal le conduit à attribuer le bien à Dieu, et non pas le mal. « Le Juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste ? (Genèse 18 v. 25) ».
Obligation vis-à-vis de Dieu, et conscience.
Mais le bien et le mal se rattachent à des obligations et se mesurent d’après des relations. Je dois à un père, à un mari, à mon prochain, ce qui convient à chacune de ces relations ; il en est de même quant à Dieu ; le sentiment du bien et du mal (là où il n’est pas perverti) met Dieu à sa vraie place, et ne le juge pas. On ne s’est pas formé une idée de Dieu, mais on a reconnu une relation, et on est soumis. C’est ainsi qu’Adam a vécu en paix avant la chute, reconnaissant la suprématie et l’autorité divines ; mais en acquérant la connaissance, il a transgressé la relation.
Or, en supposant ce sentiment du bien et du mal dans l’homme, sentiment qui est lié aux relations dans lesquelles il se trouve, j’affirme que Dieu aime la justice et qu’il hait l’iniquité, parce que je connais intrinsèquement le bien et le mal, et que, saisissant ce qu’est le bien et le mal, dans la relation, je reconnais que Dieu est suprême, souverain sur mon esprit ; c’est le premier des droits. Dieu est Dieu, comme mon père est mon père, et, comme Dieu, je lui dois la soumission. J’affirme qu’il doit être juste, car la justice est l’expression de ce que c’est qu’agir conformément à ce qui est droit et bon dans les relations dans lesquelles Dieu a placé ses créatures, en tant que cela est compatible avec sa suprématie et sa justice. Mais ceci n’est pas la suprématie de la conscience, comme si j’étais juge, et que ma mesure ou mon discernement du bien et du mal fussent parfaits ; mais de l’idée abstraite de bien et de mal, je conclus que le bien est en Dieu, et en même temps, comme mon point de départ, la suprématie et la perfection.
Il ne faut pas confondre la. mesure du bien et du mal avec le sentiment du bien et du mal. Parler de suprématie de la conscience, c’est prétendre que la mesure de celle-ci est parfaite et suffisante, au lieu de reconnaître qu’elle nous place sous une obligation. Quand je juge Dieu, ou qui que ce soit, je juge d’après une certaine mesure ; et il se peut, selon l’état de mon propre esprit, que je porte un jugement faux. Cela n’est pas la conscience. La conscience, quand elle est avec Dieu, reconnaît aussi une autorité au-dessus d’elle, et une autorité suprême ; sinon Dieu n’est pas reconnu du tout, et c’est là simplement l’athéisme. Ce que veulent les incrédules modernes, c’est de faire de leur conscience la mesure du bien et du mal : prétention à, la fois fausse et grossière, qui détruit la nature même de Dieu et son droit.
Essence de Dieu : Amour et lumière.
Mais reprenons la question de qualités relatives en Dieu. Elles supposent d’autres choses, outre l’Être absolu. Si Dieu est juste, il faut, quoiqu’il soit tel en lui-même, qu’il le soit envers d’autres : c’est une chose relative. Il n’y a que deux mots qui nous disent la nature de Dieu : Dieu est « Amour », et il est « Lumière ». Ces deux mots déclarent ce que Dieu est dans son essence ; ce ne sont pas des attributs. L’amour c’est la bonté, mais la bonté en suprématie ; car la bonté, dans sa nature abstraite, est identifiée avec la suprématie ; il faut qu’elle soit libre ; c’est en cela qu’elle diffère du désir, même quand il s’agit d’un saint désir.
Le mot amour, au sens le meilleur et le plus aimable, est, je le sais, employé dans le langage humain pour le désir. Il peut exprimer le sentiment d’un inférieur envers son supérieur, ou même d’un égal envers son égal, mais même dans son acception la plus élevée, l’amour, au sens humain, est lié à un mobile, il est mû. Cependant, l’amour, en tant qu’il est la bonté même, est bienheureux en soi et libre dans son activité, à moins que le besoin ou la misère ne l’appellent à se déployer ; il n’a pas de mobile qui le caractérise comme objet ; le désir, au contraire, a toujours un objet qui le détermine, même quand il n’est nullement mauvais, mais qu’il a le caractère de l’affection.
S’agit-il de désirs ordinaires, ils forment pour autant le caractère ; l’argent, la puissance, le plaisir, impriment leur caractère sur l’homme qui les recherche ; mais, quoique le mot amour soit employé pour désigner ces désirs, il l’est évidemment dans un sens moins élevé ; et partout où il y a des désirs, l’objet désiré pour autant nous gouverne. Quand l’amour existe dans une relation formée par Dieu, il est, ou peut être, une affection légitime. Je dis qu’il « peut être », parce qu’il peut aussi dégénérer en un simple désir, devenir de l’idolâtrie, et fausser ainsi la relation. Mais, quand cet amour est justement en exercice, il se porte (sauf sous certains aspects où l’homme représente Dieu) sur ce qui est au-dessus de lui, et caractérise celui en qui est cette affection. Ainsi l’amour est conjugal, filial, etc. Sous certains rapports, un mari, un père, représentent Dieu dans ces relations où ils se trouvent, et, dans cette mesure, l’amour participe de ce que Dieu est. Mais, à part ce cas, dans la relation la plus intime, il a le caractère dont j’ai parlé : « Ton désir sera tourné vers ton mari, et lui dominera sur toi (Genèse 3 v. 16) ».
Mais Dieu se suffit à lui-même, et la bonté le rend infiniment heureux en lui-même. Car la bonté en Dieu est heureuse sans avoir d’objet ; comme aussi elle est heureuse en elle-même, quand elle s’exerce envers un objet. Elle est donc libre, parce qu’elle se suffit à elle-même. Il en résulte que, puisque l’homme ne peut se suffire à lui-même, et ainsi être libre et souverain (quoique, dans certaines relations, il puisse être l’image de Dieu), on ne peut dire de lui qu’il soit amour, bien qu’il doive marcher dans l’amour. S’il est dans un bon état, il est nécessairement dépendant, et il reçoit. La nature divine est dans le chrétien, et il aime ; toutefois, « nous aimons, parce que Lui nous a aimés le premier (1 jean 4 v. 19) ».
Mais nous sommes lumière dans le Seigneur. La pureté de nature qui appartient essentiellement à Dieu devient nôtre dans le nouvel homme. En tant qu’elle agit en nous, elle manifeste dans leur vrai caractère toutes les choses qui nous entourent. Christ était amour dans le monde, et il était la lumière du monde : il est la mesure de l’un et de l’autre pour nous. C’est une chose très précieuse, que les deux noms essentiels de Dieu soient l’expression du nouvel homme en nous ; seulement, comme nous l’avons vu, il n’est pas dit que nous soyons amour. Mais ce qui constitue la nature de Dieu, nous caractérise, et nous fait jouir de lui, et nous fait agir ici-bas, par grâce, selon ce caractère.
Attributs de Dieu.
L’amour et la lumière, nous venons de le dire, ne sont donc pas des attributs. Les attributs sont des idées que nous rattachons à Dieu en rapport avec ce qui est en dehors de lui, quoique ces attributs lui appartiennent nécessairement comme Dieu. Il est omnipotent, omniscient, souverain ; il est aussi juste, saint ; ces deux derniers attributs, quoique plus intimement liés avec sa nature, sont des termes relatifs. Pour appeler Dieu juste, il faut que je pense à ses voies et à ses droits. Il juge de quelque chose, quand il est juste ; seulement, cela implique qu’il juge toujours justement.
Pour l’appeler saint, il faut que je pense au mal qu’il rejette. C’est pourquoi Dieu n’est pas appelé justice, ni sainteté, mais juste et saint. Ce qu’il dit est la vérité, mais il n’est pas la vérité. La vérité est ce qui est affirmé justement d’une autre chose : or Dieu n’est pas affirmé touchant autre chose ; donc on ne peut dire que Dieu soit la vérité ; mais nous pouvons dire que Christ est la vérité, parce qu’il révèle exactement ce qu’est toute chose, — ce que Dieu est, ce qu’est l’homme parfait, et, par contraste, ce qu’est l’homme pécheur, ce qu’est le monde, et qui en est le prince.
C’est par Lui que tout est manifesté exactement dans son vrai caractère. Nous disons donc que Dieu, en lui-même, est absolument amour et lumière, la lumière exprimant la pureté parfaite (invisible en elle-même), manifestant toutes choses telles qu’elles sont devant Dieu, et éclairant le chemin devant nous ; de plus, Dieu est juste, saint, omniscient, omnipotent, suprême, etc. ; tous ces termes sont relatifs, les deux premiers comme attributs moraux, les derniers se rattachant à sa nature.
Justice et sainteté.
La justice est la perfection dans les relations où l’on se trouve, ou le fait d’être conséquent avec ces relations, le mal et le bien étant connus. La sainteté est l’aspect du cœur, que la pureté intrinsèque de la nature revêt par rapport à d’autres choses, selon leur caractère. Nous pouvons parler de choses comme étant saintes, quand elles sont entièrement mises à part pour Dieu, et séparées de tout usage profane ; mais, à proprement parler, la sainteté se rapporte à des personnes qui expriment leur horreur du mal et les délices qu’elles trouvent dans ce qui est pur et bon. Dieu est saint en lui-même, haïssant le mal, et trouvant ses délices dans ce qui répond à sa nature parfaite.
La créature ne peut être sainte qu’en tant qu’elle est séparée pour Dieu selon ce qu’il est dans sa perfection, parce que la nature de la créature ne peut avoir de vrai et parfait objet que lui, et la nature d’une créature est caractérisée par son objet : la sainteté est l’expression d’une nature, non pas l’obligation rattachée à une relation. Nous sommes saints en tant que, ayant Dieu pour objet, chaque mouvement de la pensée en nous répond à l’empreinte et au caractère de Dieu. Du moment que je m’occupe de quelque objet que ce soit en lui-même, en dehors de Dieu, il est nécessairement indépendance et péché, car Dieu est mis de côté. Aucun objet ne peut régler nos cœurs, que Lui seul.
Nous ne pouvons laisser Dieu de côté, comme auteur des relations dans lesquelles nous sommes, et comme leur donnant l’autorité ; mais, parce que nous sommes placés dans certaines relations, la justice a un champ un peu plus vaste que la sainteté, bien que Dieu doive être introduit comme sanction de ces relations. Mais toutes les fois qu’une relation, reconnue de Dieu, existe, il est injuste de ne pas agir d’une manière conséquente avec elle, de n’être pas fidèle à l’obligation qui s’y rattache.
Justice de Dieu manifestée en Christ.
Or Dieu, étant juste, maintient judiciairement toute obligation que nous impose une relation quelconque, mais avant tout et par-dessus tout, celle que nous impose notre relation avec lui-même selon sa suprématie et sa nature morale ; et c’est cette relation qui est la base et le soutien de toutes les autres. Seulement le christianisme a apporté une seconde et plus parfaite mesure de notre relation avec Dieu. Il reconnaît, sans doute, ce qui, selon la mesure de l’homme, est dû par l’homme, ses obligations dans la place qu’il occupe à l’égard de Dieu et de son prochain. La loi en est la parfaite mesure, Dieu, quand il l’applique, ayant égard à notre ignorance.
Mais, en outre, Dieu lui-même a été parfaitement glorifié par le Seigneur. Tout ce que Dieu est a été glorifié en Christ, là où le péché a fourni occasion à la pleine révélation de tout ce qu’Il est ; et un nouveau fondement de relation a été posé dans l’œuvre de Christ, conforme à ce que Dieu est. C’est en vertu de cela que l’homme est dans la gloire de Dieu, en cela que la justice de Dieu est manifestée.
Le jugement est basé sur les obligations mêmes qui sont fondées sur la relation dans laquelle l’homme se trouve. L’acceptation va beaucoup plus loin ; elle est selon la valeur de l’œuvre du Seigneur : nous sommes faits justice de Dieu en lui. Mais Dieu maintient en justice toutes les relations dans lesquelles l’homme se trouve selon sa volonté.
Justice de Dieu en gouvernement.
Il est bon aussi de distinguer entre la justice de Dieu en gouvernement et le caractère immuable de Dieu, selon lequel il faut que nous soyons devant lui, si nous sommes dans sa présence révélée. L’exigence révélée de sa justice, jointe à la longue patience qu’il exerce dans sa bonté, forme la base de son juste gouvernement, qui ne sera jamais pleinement révélé jusqu’à la venue de Christ, mais qui a été partiellement manifesté en Israël, là où cela était nécessaire pour en maintenir partout le souvenir, et manifesté aussi d’une manière signalée dans le déluge qui mit fin à l’ancien monde.
Mais le fait d’être devant Dieu pleinement révélé, suppose, non pas nos obligations envers lui dans le gouvernement qu’il exerce pour maintenir son autorité, ni le sens naturel du bien et du mal, ou la règle révélée qui en est donnée, mais suppose que nous sommes rendus propres pour la présence même de Dieu ; or cela ne se trouve qu’en Christ seul, et n’est pleinement révélé que dans le christianisme, qui lie à cette révélation celle de la colère du ciel (Romains 1 v. 1 à 20).
Quand je parle de ce qui est saint, je ne pense pas, comme quand il s’agit de justice, à l’autorité judiciaire, mais à ce qu’une nature pure abhorre et rejette, ou à ce dont elle fait ses délices. Juste et saint sont les attributs qui se rattachent à la nature morale de Dieu et à son autorité suprême.
Sentiment de l’Être suprême chez l’homme et dans les diverses religions.
Mais il y a en Dieu ce dont l’homme perd difficilement le sentiment, quoiqu’il soit sans Dieu dans le monde ; et c’est pourquoi le sentiment d’un Être qui est au-dessus de lui, parfait en connaissance et en puissance, la conscience de l’existence d’un Être suprême a fait place chez l’homme à ce qui est le fruit de l’imagination ou d’une crainte servile, la mythologie et le fétichisme.
L’homme déifia les puissances visibles de la nature, parce que son cœur avait besoin d’un Dieu ; les légendes des anciens temps devinrent pour lui les mythes des dieux. La terreur lui fit appréhender une puissance vengeresse, et sa conscience mal à l’aise entrevit, menaçant pour l’avenir, un monde de rétribution. L’homme attribua la vie aux planètes, parce qu’elles se mouvaient sans lui. Dans la Grèce superficielle et suffisante, il eut des convoitises poétiques ; en Égypte, une sobriété plus calculée, un midi rayonnant de dieux ; en Scandinavie, l’immensité des géants, des tempêtes, des montagnes du nord. Ou bien, en Perse, l’esprit humain cherche à résoudre le mystère du bien et du mal en Ormuzd et Ahriman ; dans l’Inde, il s’abandonne à de monstrueuses rêveries. La cruauté et la poésie, sous le nom de dieux, se partagent le monde ; mais derrière tout cela, il y a partout, selon l’expression de Tertullien : « Testimonium animae naturaliter christianae » (*), un Dieu inconnu, un Brahm, l’origine de toutes choses, une source ou puissance primordiale.
(*) « Le témoignage d’une âme naturellement chrétienne ».
Dans le fétichisme, l’idée de cette source primordiale dégénère jusqu’à n’être que la crainte de quelque puissance terrible et inconnue, exploitée par les prêtres à leur profit ; dans les religions plus cultivées, cette même idée fut conservée par les prêtres, comme une connaissance secrète et mystérieuse n’appartenant qu’à eux ou aux initiés, tandis qu’ils entretenaient le vulgaire des sujets plus ordinaires qui formaient le bagage habituel de la mythologie populaire — dieux et déesses de la nature et de l’imagination, revêtus cependant par eux, dans leur inconséquence, d’attributs et de pouvoirs qui, s’ils étaient vrais, ne pouvaient appartenir qu’au seul Dieu suprême. Or ce fait était si évident, que la mythologie de chaque pays, souvent même de chaque cité, revêtait ce double caractère.
Dans l’Inde, chez les sectaires de Vichnou et de Siva, qui reconnaissaient un Dieu suprême, au-dessus des autres, l’idée de Dieu, avec ses attributs de suprématie, d’omniscience et d’omnipotence, se retrouve partout, malgré toute la confusion et l’inconséquence du système. Ces attributs furent aussi symbolisés, par exemple dans les taureaux, les lions, les hommes ailés de l’Assyrie, symboles reconnus dans l’Écriture, mais avec cette différence immense que, dans les symboles païens, à part une notion vague de la Divinité, l’idée qu’on se faisait de Dieu ne dépassait pas les attributs ou les symboles.
Dans le judaïsme, ces symboles ne faisaient que constituer le trône d’un Dieu connu qui siégeait au-dessus d’eux, d’une part, l’expression la plus claire de l’esprit de l’homme, se perdant sans Dieu dans une connaissance qu’il ne pouvait retenir ou conserver, et, d’autre part, la clarté de la révélation qui faisait connaître un seul vrai Dieu (*). La suprématie, l’omniscience, l’omnipotence, s’attachent nécessairement à l’idée que nous avons d’un seul Dieu, du moment que cette pensée prend une forme déterminée et que les attributs qui y sont impliqués ne se perdent pas dans des données mythologiques.
(*) Voyez le commencement d’Ézéchiel : Dieu siégeait au-dessus de ces figures. L’extrême perversité, et je dois ajouter, la superficialité de l’esprit humain, son incrédulité, se montrent dans la « Science de la Religion », de Max Muller, et autres ouvrages du même genre, qui accréditent et exaltent la mythologie, parce qu’elle était au fond l’idée de Dieu, comme si la mythologie était l’expression de cette idée : elle était, au contraire, l’égarement grossier de l’esprit humain qui, lorsqu’il possédait l’idée de Dieu, l’a dégradée quand l’homme s’est éloigné de Lui, et l’a liée à la souillure et la cruauté les plus abjectes, de manière à perdre à la fois Dieu dans sa vraie nature et la conscience, à les perdre "moralement", car ni Dieu ni la conscience ne peuvent être anéantis.
Dans le paganisme, où ces activités sont attribuées à des énergies subordonnées, le seul Dieu originel n’était qu’une déité abstraite et inerte, une existence abstraite. Dans l’Inde, le Dieu originel était la seule existence, jaillissant quelquefois en activité de pensée et de désir, qui toute devenait "création", y compris les dieux mêmes, et rentrait comme Maya, ou Illusion, dans la déité abstraite, quand cessait l’activité momentanée de Brahma.
Le matérialisme moderne ne fait guère autre chose que de substituer les activités scientifiques de là nature aux activités poétiques, ce qui ne vaut ni plus ni moins ; car après tout il nous faut une cause. Le phosphore peut communiquer de l’activité au cerveau (non pas une pensée morale) ; mais qu’est-ce qui met cette activité dans le phosphore, ou lui donne cette influence sur l’esprit ? De fait, partout où je trouve une différence régulière produite par un seul et même agent, je conclus que quelqu’un doit être l’auteur de la différence. La conviction d’une intention, d’une pensée, s’impose à moi quand je vois les racines d’une plante convertir les éléments du même sol soit en un géranium, soit en un chêne.
Omniprésence et Éternité : des attributs ?
Je ne rapporte pas à Dieu, comme attributs, l’omniprésence et l’éternité, non pas qu’on ne puisse, d’une manière générale, en parler dans ce sens ; l’Écriture même, dans le sens pratique, en parle ainsi (or l’Écriture parle toujours pratiquement, vu qu’elle parle avec vérité) ; mais, dans notre esprit, l’omniprésence et l’éternité ont trait au temps et à l’espace, qui ne s’appliquent pas à Dieu. Il n’y a aucun temps où Dieu ne soit pas, aucun espace où, pour employer le langage humain, son œil et sa main ne se trouvent pas. « JE SUIS » est l’expression propre de son existence. Pendant que le temps s’écoule, « JE SUIS » reste immuable ; et quand le temps aura cessé, « JE SUIS » subsiste encore le même. On ne peut guère appeler cela un attribut ; mais ce point une fois établi, nous pouvons parler d’« éternel », comme d’un attribut naturel de Dieu.
Quant à l’omniprésence, Dieu n’a pas plus affaire avec l’espace qu’avec le temps. Il a créé toutes choses, de telle manière que nous les concevons dans le temps et dans l’espace. Dans cette création rien ne lui échappe. Il est, moralement parlant, omniprésent. Il n’est pas de cette création, ni dans cette création, mais il la remplit, la pénètre. Il est « partout (Éphésiens 4 v. 6) ». Il soutient toutes choses, comme aussi il crée tout. Il n’intervient moralement dans aucun des mobiles qui gouvernent ses créatures (sauf qu’il opère en grâce dans l’homme) ; mais pas un passereau ne tombe à terre sans lui.
Omnipotence et omniscience.
L’omnipotence (= toute puissance) est, comprise dans ce qui précède, c’est la puissance qu’il a de faire tout ce qu’il veut. L’omniscience (le fait de tout savoir) y est comprise aussi. Si Dieu ne connaissait pas toutes choses, il ne saurait que faire justement, ni ne pourrait juger moralement. La suprématie est impliquée dans l’idée même que nous avons de Dieu comme étant UN, et comme agissant en puissance. L’omnipotence et l’omniscience sont inhérentes à l’idée que nous avons de Dieu, et ne peuvent en être séparées, dès qu’on a mis de côté les imaginations que, de l’aveu de tous, le paganisme y a ajoutées.
Ce qu’il est important de saisir et de tenir ferme, est qu’il y a une volonté en Dieu, aucun être moral n’en est dépourvu, une volonté guidée par la justice et la sainteté, et à laquelle l’omnipotence et l’omniscience sont subordonnées, mais qui est la source et l’origine de tout ce qui existe en dehors de lui-même, non pas la source et l’origine de son état (car les êtres moraux ont une volonté), mais de son existence.
Le sentiment d’un Créateur chez l’homme.
Dieu est Créateur. Je ne dis pas qu’on puisse prouver par une déduction logique que la simple existence soit un objet de création. Mais la simple existence est une abstraction. L’homme voit des arbres, des planètes qui se meuvent ; il voit, en un mot, l’évidence d’une intention, ce qui, comme on l’a si souvent exprimé, implique un auteur de l’intention. La connaissance claire et positive d’un Créateur est une affaire de foi. Cependant, si l’homme suppose l’existence abstraite de la matière sans une cause, il viole les premiers principes de la pensée. Il est accoutumé à voir les hommes former bien des choses d’une matière comparativement informe, en sorte qu’il a une idée de celle-ci.
Mais, quand il commence à réfléchir pourquoi une chose quelconque existe, il ne peut éviter la pensée d’une cause, car le « pourquoi » l’implique : je puis dire : « pourquoi » ; c’est ma nature de le dire. Je suis constitué de telle façon que je cherche une cause (*). Il se peut que je ne sache pas la définir, de même que je ne puis concevoir la création ; mais, d’autre part, je ne puis concevoir qu’une chose puisse exister sans qu’elle ait été créée. Il est possible que mon esprit soit inerte, et que j’accepte sans réflexion ce qui existe comme je le trouve ; mais aussitôt que mon esprit est en activité, il cherche à savoir pourquoi une chose existe. Le même fait prouve que je ne puis connaître une cause première, mais que je sais seulement qu’il doit en exister une. Je ne puis concevoir quoi que ce soit sans que la chose qui existe ait une cause, c’est pourquoi je dis qu’il faut une cause. Mais une cause première est ce qui existe sans cause, cela revient à dire que je ne puis la concevoir ; par conséquent aussi je ne puis pas concevoir la création, quoique je sache qu’il doit nécessairement y avoir un Créateur ; autrement dit : je suis une créature, et il faut que je pense selon l’ordre de mon être.
(*) Une cause, je pense, est une puissance produisant un effet, — une volonté qui agit quelque part. Je dis « quelque part », comme disent les scolastiques ; car il y a « causa causata », et « causa causans » (une « cause causée, et une « cause causante »).
La bonté ou l’amour, l’omniscience et l’omnipotence, impliquent la parfaite sagesse ; seulement tout ceci suppose l’existence d’un Dieu, ayant une volonté libre, avant qu’on puisse lui assigner aucun attribut. S’il n’est pas libre d’agir, l’omniscience et l’omnipotence sont tout simplement nulles.
Philosophes et Création : concevoir ce qui est au delà de l’homme.
Une classe de philosophes, incapables comme nous le sommes, puisque nous sommes tous des créatures, de concevoir une création (car la créature doit penser selon son propre ordre, l’ordre d’une créature, et ne peut pas plus avoir une idée de la création qu’elle ne peut créer, n’ayant pas de puissance en elle-même), ces philosophes, dis-je, affirment que : « Ex nihilo nihil fit » (*). Cela est vrai à leur point de vue ; mais le fait de prendre notre capacité de pensée et d’action pour mesure de ce qui peut être, n’est autre chose que le grand sophisme habituel à la philosophie ; c’est tout simplement une absurdité ; c’est notre mesure quant à la puissance, qu’il s’agisse de pensée ou d’action. Il faut que nous pensions, que nous agissions conformément à notre nature, et nous ne pouvons penser au delà pour ce qui est de former des idées. Mais tout ce système est entièrement faux, s’il nie que nous puissions avoir conscience de ce qui est au-dessus de nous et que nous sommes susceptibles de recevoir. Il se peut que nous soyons mentalement et physiquement sous l’action d’une puissance que nous ne possédons pas en nous-mêmes. La puissance active ou la capacité de l’exercer, n’est pas la mesure de ce que nous sommes susceptibles de recevoir.
(*) « On ne fait rien de rien »
De plus, négativement, je puis avoir conscience de la nécessité d’une chose dont je ne puis me former aucune idée, parce qu’elle est au delà de l’ordre de mon être. Ainsi je reporte naturellement un effet à une cause, à une puissance qui le produit. Je vois qu’une chose devient, qu’elle commence à exister, telle qu’elle se présente à moi, et aussitôt je l’attribue à quelque cause. Je suis constitué de telle sorte que je suppose un « pourquoi ? » Aucune chose ne peut exister sans une cause. Cela ne veut pas dire que je me rende compte de la nature de cette cause, mais j’ai la conviction qu’il doit y en avoir une. Ce qui existe m’apparaît comme un effet, et l’effet renferme en soi l’idée d’une cause. Je crois donc à la création ; non que je m’en rende compte, mais que, négativement, elle ne peut pas ne pas exister.
Connaissance de Dieu par la conscience et la création.
La nature même de la preuve démontre, comme je l’ai déjà dit, que je ne puis me former une idée de la chose prouvée, telle qu’elle est en soi. Mais ce qui s’y voit clairement, c’est la puissance et la divinité éternelles. Et remarquez ici que la puissance créatrice suppose la puissance éternelle, car tout commence par la création, et toute création a un commencement. Mais ce qui crée doit être, c’est-à-dire doit exister, absolument sans commencement. « Je Suis », ou l’existence absolue, est par conséquent la seule juste révélation de Dieu comme tel.
Nous avons donc un Dieu personnel « Je Suis », un Dieu suprême, absolument libre, omniscient, omnipotent, sage, le Créateur. Ce sont là, pour ainsi dire, des attributs naturels ; juste, saint, bon, sont des attributs moraux. Ces attributs sont connus à l’homme, non par des idées ou par la réflexion, ce qui serait impossible, car alors l’esprit de l’homme serait au moins l’égal de Dieu, c’est-à-dire que Dieu ne serait pas Dieu du tout, mais ils sont connus par la conscience, ou la connaissance du bien et du mal, par les preuves de puissance et de sagesse créatrices que fournit la création qui nous entoure, enfin par l’idée d’un Dieu, par le sentiment constant d’unité, de suprématie, de divinité absolue, qui se retrouve partout, en dépit de la dégradation complète et incontestable de l’homme tombé dans la corruption et la violence, et malgré les déités monstrueuses dans lesquelles l’homme a, pour ainsi dire, noyé l’idée de Dieu.
Encore l’Être suprême dans les religions des hommes.
Si Jupiter est nourri par une chèvre dans l’île de Crète, l’idée de suprématie demeure. Si Krichna vit avec les bergères, c’est qu’il est, dans le cours des temps, une incarnation de Vichnou, et Vichnou est Brahm, le reste n’est que Maya ou Illusion. Les dieux sont mortels ; Dieu ne l’est pas. Peut-être sera-t-il représenté par Bathos ou le Silence, ou par quelque autre notion tout à fait vague, quand le faible esprit de l’homme cherche à donner une forme à sa pensée ? Mais, avant qu’il agisse, et derrière les dieux de l’imagination, des convoitises ou des terreurs, il n’y a pas la divinité seulement, mais un Dieu. Pour l’Indien, c’est le Manitou ; ailleurs, c’est l’Être éternel, existant avant qu’Ormuzd fût actif pour produire le bien, ou qu’Ahriman intervînt pour gâter son ouvrage.
Et remarquez ici que, lorsqu’une idée découle d’une relation dans laquelle nous sommes, relation qui appartient à notre nature dans sa constitution originelle, la pensée et l’imagination, l’éducation, les habitudes religieuses, l’influence cléricale, peuvent pervertir cette idée, la falsifier, la dégrader (et l’esprit de l’homme avec elle), ou la contredire par le raisonnement, à cause de l’incapacité où se trouve l’esprit de s’en rendre maître ; mais les racines de cette idée sont dans la nature. Pour qu’une notion puisse être falsifiée, il faut qu’elle existe. « Naturam expellas furcâ, tamen usque recurret » (*). Aussi, quelque porté que soit l’esprit humain à se livrer à son imagination, à se tenir à distance de Dieu qu’il craint, et à avoir des dieux et des idoles qu’il peut former selon ses propres convoitises et ses propres pensées, lorsque la vérité de la relation est mise en lumière, l’âme la reconnaît.
(*) « Chassez le naturel, il revient au galop ».
Sentiment de l’existence de Dieu, moralité et religions.
L’unité, la suprématie, l’omniscience, l’omnipotence de Dieu, et notre responsabilité envers lui, sont reconnues par tous comme la seule vérité, quand la révélation divine les a mises en lumière. Je ne veux pas dire par là que l’esprit de l’homme ne puisse nier tout cela, ou ne cherche à le faire, pour se passer absolument de Dieu, parce qu’il n’aime pas à en avoir un, qu’il hait la responsabilité, et qu’il veut être suprême, ou tout au moins ne rien avoir au-dessus de soi. Mais c’est là un effort, dont les effets ne durent jamais longtemps dans les masses, c’est-à-dire dans l’homme selon la nature, effort qui, du reste, est toujours lié avec l’oppression, ou la violence et la licence, comme lors de la chute de l’empire romain et à la révolution française.
Il faut alors que la moralité disparaisse ; car il ne peut y avoir de moralité sans responsabilité ; et, sans Dieu, la responsabilité est impossible. À qui suis-je donc responsable, si je n’ai personne au-dessus de moi ? La responsabilité se rattache à la relation, et toute relation (même humaine) est fondée sur la relation avec Dieu. Sans lui, c’est la volonté propre qui agit, chacun veut suivre sa volonté ; et l’homme devient un mélange du diable et de la brute ; ou bien il devient esclave du pouvoir, parce qu’il y est obligé, ou pis encore ; tandis que le pouvoir, en résultat, cultivera la superstition à cause de l’empire qu’elle exerce sur les esprits des hommes. Et certes, partout où la foi et la révélation ne fournissent pas une vraie sphère de pensée et d’action en dehors du moi, l’homme, ne pouvant se reposer sur lui-même, s’en fera une fausse. C’est ce qui, sous la puissance de Satan, produit les religions du monde.
Dieu révélé.
La révélation, en faisant connaître le vrai Dieu, répond non pas à la connaissance, mais aux besoins de l’esprit humain. Elle est le témoignage de sa propre vérité, parce qu’elle atteint et dégage ces sources dans l’âme, qui étaient l’adaptation subjective à la relation dans laquelle l’âme se trouvait devant Dieu en réalité ; or la révélation objective s’adapte parfaitement à ces besoins, et selon cette mesure Dieu est connu (*).
(*) Ainsi il arrive que là où la révélation existe, Dieu est reconnu même s’il n’y a pas de vraie conversion. C’est ce qui constitue la supériorité morale du protestantisme (qui reconnaît la véritable révélation et l’applique individuellement) sur le papisme, qui a construit un système mythologique de saints, etc., et établi un clergé, ce qui est et doit être toujours le cas, lorsque Dieu n’est pas connu d’une manière directe et immédiate. Dans le protestantisme, la conscience a affaire, d’une façon immédiate, à Dieu révélé ; dans le catholicisme romain, il n’en est pas ainsi : le prêtre y est directeur.
Quand nous ouvrons les Écritures, nous y trouvons à chaque page les attributs de Dieu — du seul vrai Dieu — et nous les y voyons briller d’un éclat sans nuage. Il est un, il est suprême, il est le Créateur des cieux et de la terre, de toutes choses ; il connaît toutes choses. Si nous montons aux cieux, il y est, si nous nous couchons au hadès, il y est (comp. Jérémis 23 v. 24) ; il peut toutes choses, son œil et sa présence sont partout ; il est le Dieu éternel ; il est juste et saint ; sa bonté est sur toutes ses œuvres. Les aspirations du cœur de l’homme sont satisfaites par la révélation de Dieu la plus claire et la plus entière. Je parle de l’Ancien Testament, parce que c’est là que Dieu, comme tel, comme seul vrai Dieu, est pleinement, directement et spécialement révélé, en contraste avec les idoles et les imaginations de l’homme, et cela par le moyen de la loi qui est sortie de sa bouche, accompagnée de promesses et de prophéties.
Inutile d’ajouter que le Nouveau Testament confirme pleinement la révélation de l’Ancien ; mais il apporte une révélation beaucoup plus complète, en ce que le Père a envoyé le Fils pour l’accomplissement de ses voies en grâce ; et c’est là ce qui caractérise le Nouveau Testament.
Dieu n’y donne pas une révélation ; il y est révélé. Ainsi, quoique sans doute les attributs restent vrais, ce ne sont pas des attributs qui le caractérisent, mais bien ce que Dieu est : il est lumière et il est amour ; la justice et la sainteté s’y trouvent nécessairement aussi, mais sa justice et sa sainteté, non pas ce qui est exigé de l’homme, pour Dieu, car alors le caractère de ces attributs comme révélés, serait entièrement changé.
Dans l’Ancien Testament, nous pouvions dire : « L’Éternel juste aime la justice (Psaume 11 v. 7) » ; « le Juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste ? (Genèse 18 v. 25) ». Maintenant, Lui, Christ, est notre justice, et nous sommes devenus justice de Dieu en Lui. C’est dans le Nouveau Testament que nous trouvons Dieu révélé en Christ comme lumière et amour ; et nous qui sommes « lumière dans le Seigneur », et « participants de la nature divine », nous devons marcher dans la lumière, et connaître, par la rédemption qui est en Christ, cet amour parfait qui chasse la crainte.
Cela est plus que des attributs, comme nous l’avons dit, bien que cela les confirme, en soit la source, dans un certain sens, les fasse connaître tous, et fournisse à chacun d’eux sa propre et vraie place.
 Un message de John Nelson Darby
Un message de John Nelson Darby
© Reproduction gratuite autorisée en indiquant l'auteur et la source bible-foi.com.