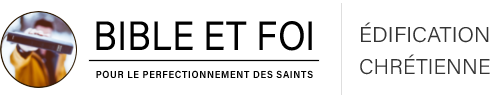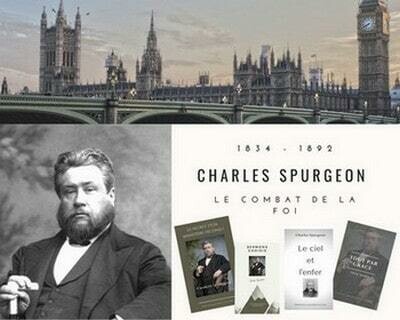
11. Sermons choisis
Chap: 6 - Conseils aux âmes abattues - Le devoir de tout ministre de l’Évangile est de, tantôt avertir les forts, de peur qu’ils ne tombent dans la présomption ; et tantôt stimuler ceux qui dorment, de peur qu’ils ne dorment du sommeil de la mort.
« Oh ! qui me ferait être comme j’étais autrefois » (Job 29 v. 2). « Le plus souvent le bon Berger conduit ses rachetés le long des eaux tranquilles, et les fait reposer dans les parcs herbeux ; cependant, il permet parfois qu’ils soient errants dans un désert où il n’y a point de chemin, et où ils ne trouvent aucune ville habitée. Ils sont affamés et altérés ; leur âme défaille, et ils crient à l’Éternel dans leur détresse » (Psaume 107 v. 4 à 6).
De même, il est beaucoup d’enfants de Dieu qui jouissent d’une joie à peu près constante ; pour eux véritablement les voies de la piété sont des voies agréables et ses sentiers ne sont que prospérité ; mais il en est d’autres, au contraire, qui ont à passer dans le feu et dans l’eau ; selon l’expression du Psalmiste, « les hommes montent sur leurs têtes » (Psaume 66 v. 12) ils sont en butte à toutes sortes d’épreuves.
Oui, je me sens pressé de consoler ceux d’entre vous qui passent par des temps de langueur et de découragement, ou, pour mieux dire, je voudrais leur adresser quelques exhortations, qui, moyennant la bénédiction de Dieu, pourront les aider, je l’espère, à sortir de la triste condition dans laquelle ils sont tombés, en sorte qu’ils ne seront plus réduits à s’écrier avec Job : « Oh ! qui me ferait être comme j’étais autrefois ? »
En premier lieu, mes frères, nous étudierons la maladie spirituelle dont mon texte me semble être l’expression ; nous rechercherons ensuite la cause et le remède de cette maladie, et enfin, quelques mots d’exhortation adressés aux âmes qui se trouvent dans ce fâcheux état termineront ce discours.
Et d’abord, fixons notre attention sur la maladie spirituelle que suppose la plainte amère contenue dans les paroles de mon texte. Combien de chrétiens qui regardent au passé avec regret, à l’avenir avec effroi, et au présent avec tristesse ! Il leur semble que le temps qui n’est plus a été le meilleur et le plus doux de leur carrière chrétienne, mais quant au moment actuel, il leur paraît enveloppé d’un voile sombre et mélancolique. Souvent, ils se prennent à souhaiter de pouvoir retourner de quelques mois, de quelques années en arrière, car alors ils vivaient près de Jésus, tandis que maintenant, ils sentent qu’ils se sont éloignés de lui, ou qu’il leur a caché sa face ; en un mot, le langage de leur cœur revient à ceci : « Oh ! qui nous ferait être comme nous étions autrefois ».
De même que toute maladie, soit physique, soit morale, celle qui nous occupe ne présente pas toujours les mêmes caractères. Je vais essayer de décrire successivement quelques-unes de ses phases les plus ordinaires.
Voici un homme qui a perdu l’assurance de son adoption. Entendez-le répétant dans l’amertume de son âme : Oh ! qui me ferait être comme j’étais autrefois ? Écoutez son triste soliloque : « Ah ! pourquoi les jours passés ne peuvent-ils plus revenir ? » s’écrie-t-il. Alors, je n’avais aucun doute de mon salut. À celui qui m’aurait demandé raison de l’espérance qui était en moi, j’aurais répondu avec douceur et respect. Nulle crainte ne me troublait, nulle frayeur ne m’agitait. Je pouvais dire avec Paul : je sais en qui j’ai cru, et avec Job : je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sentais que j’étais assis sur le rocher qui est Christ, et mon âme, pleine d’une joyeuse confiance, était toujours prête à chanter :
« Si l’Éternel est ma retraite, Qui pourrait me troubler encore ? Pourquoi craindrais-je la tempête, Quand je suis sûr d’entrer au port ? Appuyé sur Emmanuel Que me ferait l’homme mortel ? »
« Mais hélas ! que tout est changé ! autrefois mon ciel était sans ombres, aujourd’hui les nuages le couvrent ; autrefois, je voyais, en quelque sorte, mon nom écrit dans les cieux, aujourd’hui, je tremble d’y lire un jour ma condamnation. Autrefois, je croyais me confier sincèrement en Christ, mais aujourd’hui, je suis constamment assailli par l’affreuse pensée que j’étais un hypocrite qui trompait les autres et se séduisait lui-même. Il est vrai que j’essaie encore d’espérer au Seigneur, et si je ne puis plus me réjouir à la clarté de sa face, du moins je me réfugie à l’ombre de ses ailes. Je sens que hors de Christ il n’y point de salut, et que si je m’éloigne de lui c’en est fait de moi. Mais, ô misérable que je suis ! qu’elles sont épaisses les ténèbres qui m’environnent !
Comme Paul au milieu de la tempête, que de jours sans soleil et de nuit, sans étoiles n’ai-je pas dû traverser ! J’ai perdu les arrhes de mon salut, le gage de mon adoption ; je ne possède plus le témoignage intérieur que je suis un enfant de Dieu en un mot, je crains de m’être fait illusion jusqu’à présent sur mon véritable état ; je crains d’avoir pris de simples impressions charnelles pour l’œuvre de la grâce, et attribué à Dieu le Saint-Esprit ! ce qui n’était que le fruit de mon imagination ! »
Tel est, mes chers amis, un des cas les plus fréquents de la grande maladie spirituelle que nous étudions. En voici un second, également très ordinaire. Voyez ce chrétien qui demande à son tour : « Oh ! qui me ferait être comme j’étais autrefois ? » Il gémit, non pas comme l’autre parce qu’il a perdu le sentiment de son adoption, mais parce qu’il se laisse troubler par des soucis terrestres. « Où est-elle, se dit-il avec douleur, où est-elle cette paix délicieuse qui naguère encore remplissait mon âme ? Que sont-ils devenus ces jours bénis où peines et épreuves étaient pour moi moins que rien ? Je disais constamment en mon cœur : J’accepte, ô Père, par avance, le lot que tu m’assigneras ; en toi, j’ai mis ma confiance ; fais de moi ce que tu voudras.
Je sentais que sans murmures, j’aurais pu faire au Seigneur le sacrifice de toutes choses, et que s’il m’eût enlevé ce que j’aimais le plus au monde, j’aurais dit avec Job : L’Éternel l’avait donné, l’Éternel l’a ôté ; que le nom de l’Éternel soit béni. L’avenir ne m’inspirait aucune inquiétude. Comme un enfant dans les bras de sa mère, je reposais tranquille sur le sein de mon Dieu. L’Éternel pourvoira, me disais-je.
Je me déchargeais sur lui de tout ce qui me concernait ; j’allais chaque jour à mon travail, sans m’inquiéter du lendemain. J’étais semblable au passereau qui se réveille à l’aurore, ne sachant d’où lui viendra sa nourriture, mais qui n’en gazouille pas moins son hymne matinal à
Celui qui nourrit les oiseaux de l’air. Sans crainte, je remettais entre les mains du Seigneur mes intérêts les plus chers : ma femme, mes enfants, ma vie même. Chaque matin, je priais ainsi : Seigneur, je ne crois point avoir de volonté propre ; toutefois, si j’en avais, je te dirais encore : Non point ce que je veux, mais ce que tu veux ! Ta volonté sera la mienne ; ton désir sera mon désir.
Mais, ô regret, ô douleur ! qui me fera être comme j’étais autrefois ? Qui me rendra ma confiance en Dieu, ma douce quiétude, ma sérénité d’esprit ? Maintenant, un rien me chagrine ; mes affaires temporelles, me troublent. La perte la plus minime suffit pour m’attrister, tandis qu’autrefois j’aurais supporté sans me plaindre, et même en bénissant Dieu, une perte a vingt fois plus considérable. Si le moindre nuage vient assombrir mon horizon, mon âme en est comme écrasée. Pareil à un enfant impatient et volontaire, je voudrais que tout marchât au gré de mes désirs. Je ne puis plus dire avec sincérité que je remets toutes choses à mon Père céleste : il y a un certain interdit que je me réserve.
Enlacée autour de mon cœur, croît la plante vénéneuse appelée l’amour du moi ; ses racines ont pénétré jusques aux muscles et aux nerfs de mon âme. Il y a quelque chose que je chéris plus que Dieu, quelque chose dont je refuserais de lui faire le sacrifice s’il me le demandait. Autrefois, quelque lourde qu’eût pu être ma croix, je n’aurais pas, comme aujourd’hui, plié sous le faix, car le Seigneur l’eût portée avec moi. Oh ! comment ai-je pu oublier la céleste science de se décharger de ses soucis sur l’Éternel ; de déposer tout fardeau sur le rocher inébranlable des siècles ? Oh ! si je savais comme jadis répandre devant mon Dieu mes peines et mes tristesses ! Oh ! douce confiance en mon Sauveur qui me rendait si heureux, que ne donnerais-je pas pour te posséder encore ! »
Tel autre chrétien déplore peut-être la tiédeur, qu’il apporte dans la maison de Dieu et le peu de jouissance que lui procurent les moyens d’édification. Écoutez les plaintes qui s’exhalent de son cœur à ce sujet.
« Autrefois, s’écrie-t-il, quand je montais dans la maison de Dieu, combien mon âme était joyeuse ! J’écoutais avec avidité le message du salut ; quand le serviteur de Christ parlait, je craignais de perdre une seule de ses paroles ; il me semblait qu’un ange s’adressait à moi du haut du ciel. Que de fois, en entendant parler de l’amour du Sauveur, des larmes brûlantes n’ont-elles pas sillonné mes joues ! Que de fois mes yeux n’ont-ils pas étincelé d’ardeur lorsqu’une parole de foi et d’espérance faisait vibrer mon âme tout entière ! Et les sabbats de mon Dieu, avec quel transport je saluais leur retour ! »
Puis, lorsque de saints cantiques faisaient retentir les parvis du Seigneur, quelle voix était plus joyeuse que la mienne ? Le cœur content, l’âme restaurée, je quittais le sanctuaire pour aller raconter à mes amis, à mes voisins les glorieuses vérités que je venais d’entendre. Et dans la semaine également, combien j’aimais à m’occuper des choses de Dieu ! Pas une assemblée d’édification qui ne me trouvât à ma place. Je priais véritablement en esprit toutes les prières qui étaient prononcées ; j’écoutais avec bonheur tous les discours, pourvu qu’ils fussent selon l’Évangile ; et mon âme, assise pour ainsi dire à un banquet somptueux, était rassasiée comme de moelle et de graisse.
Si je lisais l’Écriture, elle me semblait toujours brillante de clarté ; on eût dit qu’un rayon de la gloire divine illuminait pour moi ses pages sacrées. Si je ployais le genou devant Dieu, mon âme se répandait aussitôt en ardentes supplications ; je prenais plaisir à ce saint exercice, et les heures que je passais à genoux étaient les plus douces de mes journées : j’aimais mon Dieu et mon Dieu m’aimait.
Mais, hélas ! ce saint zèle, cette ferveur d’esprit, je ne les possède plus. Je vais toujours à la maison de Dieu ; j’y entends la même voix ; le même serviteur de Christ, que j’aime si cordialement, m’adresse encore les plus touchants appels ; mais je n’ai plus de larmes à verser ; mon cœur s’est endurci ; les douces émotions que je goûtais naguère deviennent de plus en plus rares. Je me rends au culte divin, à peu près comme un écolier se rend à son école : j’y vais sans plaisir, sans amour, parce qu’il faut y aller, et j’en sors l’âme aussi sèche qu’en entrant.
Lorsque je cherche à m’entretenir en secret avec mon Père céleste, il semble en vérité que les roues de mon char aient été enlevées, tant il se meut pesamment ; et lorsque j’essaie de chanter les louanges de Dieu, je me trouve sans élan et sans ferveur. Oh ! qui me ferait être comme j’étais autrefois, comme j’étais en ces jours où Dieu faisait luire sa lampe sur ma tête ? »
Je dois le dire, mes chers amis, je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup parmi vous qui puissent s’associer pleinement à un tel langage. En général, je le sais, vous aimez à venir dans la maison de Dieu ; et, pour ma part, je rends grâces à mon Maître de ce qu’il me permet de prêcher l’Évangile à des auditeurs ; qui paraissent le goûter et le sentir, à des chrétiens dont les yeux ne restent pas toujours secs en l’entendant annoncer, et dont le cœur sait parfois bouillonner d’un saint enthousiasme. Mais sans être parvenus au triste état que je viens de décrire, vous pouvez cependant en connaître quelque chose ; peut-être la Parole ne vous semble-t-elle plus aussi douce, aussi savoureuse qu’autrefois ; et alors, j’en suis assuré, les plaintes que je viens d’exprimer éveillent quelque écho dans votre cœur.
Mais passons à un quatrième cas.
Il est des chrétiens qui se lamentent amèrement parce que leur conscience n’est plus aussi délicate que par le passé. Ils disent avec tristesse : « Dans les premiers temps qui suivirent notre conversion, c’est à peine si nous osions faire un pas, tant nous craignions de nous fourvoyer. Nous éprouvions avec soin toutes choses ; nous évitions jusqu’à l’apparence du mal. Dès que nous apercevions sur notre route la moindre trace du Serpent ancien, nous nous détournions avec épouvante.
Le monde se moquait de nous ; il nous appelait des puritains. Nous étions constamment sur nos gardes ; nous avions peur d’ouvrir la bouche, et nos scrupules allaient si loin que nous condamnions certaines choses qui, en réalité, étaient innocentes. Notre conscience ressemblait à la sensitive : si la main du péché s’en approchait, aussitôt elle se reployait sur elle-même. Notre âme était comme couverte de meurtrissures, en sorte que le plus léger attouchement lui arrachait des cris. Offenser Dieu, nous paraissait être le malheur suprême ; si quelqu’un prononçait une imprécation en notre présence, nous tremblions d’effroi si nous voyions un homme violer le sabbat, nous étions éperdus.
La moindre tentation nous indignait ; il nous semblait entendre la voix du démon lui-même, et pleins d’une sainte colère, nous nous écriions : Arrière, de moi, Satan ! » Le péché, sous toutes ses formes, nous faisait horreur : nous le fuyions comme un serpent ; nous le craignions comme du poison… Mais où est-elle maintenant cette conscience si sensible et si tendre ? Qu’est devenue sa délicatesse d’autrefois ? Nous n’avons pas, il est vrai, abandonne les sentiers du Seigneur ni oublié sa loi ; nous n’avons point extérieurement déshonoré notre sainte profession, et Dieu seul connaît nos iniquités ; toutefois, nous l’avouons avec confusion, notre conscience n’est plus ce qu’elle a été. Hier encore elle tonnait contre le péché ; aujourd’hui elle garde le silence.
Ô conscience, conscience ! nous t’avons abreuvée de soporifiques, et maintenant, tu dors, tandis que tu devrais nous avertir. Sentinelle du Seigneur, ta voix pénétrante savait naguère se faire entendre jusqu’au plus profond de notre être ; mais maintenant tu es assoupie, et nous succombons à la tentation. Jusqu’à présent, nous n’avons péché que dans de petites choses, mais de même que le balancement d’un brin d’herbe indique de quel côté souffle le vent, de même ces petites infidélités ne prouvent que trop dans quelle funeste voie notre âme est engagée. Oh ! qui nous délivrera de cette conscience si épaisse, si dure, si calleuse, de cette conscience que les flèches de la loi ne peuvent plus transpercer ? Oh ! qui nous fera être comme nous étions autrefois ? »
Enfin, mes bien-aimés, il est peut-être quelques-uns, d’entre nous qui gémissent, et non sans raison, parce qu’ils n’ont pas autant de zèle pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes qu’ils en avaient jadis. Il y a quelque temps, si nous voyions une âme cheminer vers la perdition, nos yeux se remplissaient de larmes.
Si nous voyions un de nos semblables prêt à commettre un péché, nous nous élancions vers lui, le suppliant de renoncer à son coupable dessein. Jamais nous ne sortions sans donner à l’un quelque traité religieux, à l’autre quelques bons avis ; il nous semblait que nous devions toujours parler du Seigneur Jésus.
Si une occasion de faire du bien se présentait, nous étions toujours les premiers à la saisir.
Notre vœu le plus cher était de sauver quelques âmes, et si profond, si ardent était notre amour pour les pécheurs que volontiers nous eussions consenti à être moqués, hués, abreuvés d’outrages, persécutés par le monde entier, exposés même à la mort cause de Christ, si à ce prix nous eussions pu arracher un seul de nos frères à la perdition éternelle. Notre âme brûlait d’un désir intense d’amener des âmes à Christ, et nous estimions que c’était là le seul but en vue duquel il valait la peine de vivre.
Mais, hélas ! quel souffle glacial est venu flétrir ce généreux élan ? Aujourd’hui, les âmes peuvent être damnées, et nous ne pleurons point ; les pécheurs peuvent être précipités dans l’étang ardent de feu et de soufre, et nous demeurons impassibles ; des milliers de créatures immortelles peuvent être moissonnées chaque jour et tomber dans l’abîme du tourment, et cela ne nous touche point !
Nous exhortons bien encore notre prochain à fuir la colère à venir, mais nos yeux restent secs ; nous prions pour lui, mais sans que nos cœurs prennent part à nos prières ; nous lui parlons de son danger, mais sans avoir l’air de prendre ce danger au sérieux. Nous passons à côté des repaires du vice et de l’infamie : sans doute nous voudrions que ceux qui y habitent fussent meilleurs, mais c’est là tout. On dirait que la compassion même est éteinte dans nos cœurs.
Il fut un temps où l’enfer était pour nous une réalité si vivante, qu’il nous semblait sans cesse entendre les hurlements et les lamentations des réprouvés, en sorte que le cri constant de notre âme était celui-ci : « Ô Dieu ; aide-moi à sauver mon prochain ! »
Mais maintenant, nous prenons les choses plus froidement : nous avons peu d’amour pour les hommes, peu de zèle pour la gloire de Dieu, peu d’énergie pour son service… Oh ! mes bien-aimés, si tel est votre état spirituel ; si, comme votre indigne pasteur, vous pouvez vous associer dans une certaine mesure à ces tristes aveux, assurément, du fond de votre cœur humilié s’élève en cet instant même cette plainte amère : « Qui nous fera être comme nous étions autrefois ? »
2. Recherchons maintenant la cause et le remède de ces maladies spirituelles.
Le plus souvent, ce fâcheux état de choses est le résultat du relâchement dans la prière ; et quant au remède, il est facile de comprendre qu’il est l’inverse de la cause. Voyons, mon frère, qui es toujours à te plaindre de l’alanguissement de ta piété, essayons de descendre à la racine du mal. Si tu n’es plus comme tu étais autrefois, ne serait-ce pas tout simplement parce que tu as négligé la prière ? Rien ne débilite l’âme comme le manque de prière.
On l’a observé avec raison : « Un cabinet négligé est le berceau de toute sorte de mal ». On peut dire que le cabinet du chrétien est pour lui la source, soit de beaucoup de bien, soit de beaucoup de mal : de bien, s’il le fréquente assidûment ; de mal, s’il le néglige. Nul ne peut croître dans la grâce, s’il est paresseux à s’approcher de Dieu. Quelque avancé que soit un chrétien, s’il ne priait pas, il aurait bientôt cessé de vivre. L’enfant de Dieu a besoin d’être constamment substanté ; si bien nourri qu’il puisse être aujourd’hui, il ne saurait subsister demain, si ses provisions ne sont renouvelées : or, ce renouvellement incessant de grâces, c’est par la prière seule qu’il peut l’obtenir. Quand même une âme posséderait la force spirituelle de cinquante chrétiens d’élite, si elle cessait de prier, elle ne pourrait que périr.
Mon frère, examine-toi donc à cet égard ; et si en regardant en arrière, tu étais contraint à te dire : « Il fut un temps où mes prières étaient plus régulières, plus senties, plus nombreuses qu’aujourd’hui ; maintenant, elles sont faibles, languissantes, sans sincérité et sans onction ! ». Si, dis-je, ta conscience t’obligeait à faire cet aveu, oh ! mon bien-aimé, ne t’étonne plus du malaise de ton âme ; ne cherche pas ailleurs l’explication de ce marasme spirituel dont tu te sens atteint.
Le relâchement dans la prière : voilà la cause du mal.
« Mais où en est le remède ? » diras-tu. Eh ! C’est tout simple, chère âme : prie davantage. Si peu de prières t’ont réduit à l’état d’abaissement dans lequel tu te trouves, beaucoup de prières te relèveront. C’est le manque de prière qui t’a appauvrie ; c’est l’abondance de prière qui t’enrichira. « Où il n’y a point bœuf, la grange est vide, a dit Salomon » (Proverbes 14 v. 4) ; et même que sans labourage l’homme n’aurait point de pain, de même sans la prière l’âme croyant serait affamée :
Voulons-nous donc prospérer sous le rapport spirituel ? Soyons plus persévérants dans la prière. Oh ! mes chers amis, « la pierre de la muraille ne pourrait-elle pas crier contre nous, et la paroi nous condamner » (Habakuk 2 v. 11) ? La poussière de notre cabinet ne s’élève-t-elle pas en témoignage devant Dieu, nous accusant de négligence dans nos dévotions particulières ?
Voilà pourquoi nous ne sommes plus tels que nous étions autrefois. Ce qu’est pour une machine à vapeur le feu qui entretient son mouvement, la prière alimentée par le Saint-Esprit l’est pour le chrétien. La prière est le véhicule que Dieu a choisi pour faire part de ses grâces à ses enfants, et bien insensé est celui qui néglige. Mes frères, permettez-moi d’insister sur ce point, car il est de la plus haute importance. Si vous reconnaissez qu’en négligeant de vous approcher de Dieu, vous placez votre âme dans la situation la plus périlleuse, votre devoir est tout tracé : vaquez à la prière avec plus de soin que jamais. Un commerçant gémit parce que son négoce n’est plus aussi florissant qu’autrefois ; or, il avait coutume d’envoyer au loin des navires qui lui revenaient chargés d’or ; mais depuis longtemps pas un seul n’a mis à la voile : a-t-il donc le droit de se plaindre de ce qu’il ne reçoit plus de précieux chargements.
De même, lorsqu’un homme prie, il envoie vers le ciel un navire qui lui revient chargé des plus riches trésors, mais si, au lieu de cela, il laisse son navire amarré, dans le port, est-il étonnant qu’il s’appauvrisse de jour en jour ?
Mais le fâcheux état spirituel qui nous occupe peut avoir d’autres causes. Si vous êtes réduits à vous écrier : Oh ! qui me ferait être comme j’étais autrefois ? Peut-être est-ce moins votre faute que la faute de vos conducteurs spirituels. Oui, mes chers amis, il n’est pas impossible qu’une âme devienne très gravement malade, par suite de la mauvaise nourriture que lui donne son pasteur. Peut-on s’attendre, en effet, à ce qu’ils croissent dans la grâce ces chrétiens qui ne sont jamais arrosés par les ruisseaux qui réjouissent la cité de notre Dieu ? Comment pourraient-ils se fortifier dans le Seigneur Jésus, ceux qui ne sont pas nourris du lait spirituel et pur de la Parole ? Recherchez donc, avec le plus grand soin, les instructions d’un ministre fidèle.
Je connais des chrétiens qui jamais ne sortent de leur lieu de culte sans se lamenter sur le peu d’édification qu’ils y trouvent ; et pourtant (étrange contradiction !) ils y retournent régulièrement dimanche après dimanche.
En vérité, je ne sais comment qualifier une telle conduite, et bien loin d’exciter ma compassion ou ma sympathie, j’estime que ces chrétiens méritent qu’on aille à eux avec la verge. Lorsqu’il peut choisir, tout fidèle est tenu d’aller là où il trouve la nourriture qui correspond le mieux aux besoins de son âme. Sans doute, il ne doit pas changer de lieu de culte à la légère ; mais si une longue expérience l’a convaincu que la prédication qu’il entend habituellement ne lui tourne pas à profit, au lieu de perdre son temps en vaines doléances, il est de son devoir d’aller ailleurs. Souvent un pasteur infidèle affame, pour ainsi dire, son troupeau ; il réduit les brebis du Seigneur à l’état de squelettes ambulants, en sorte qu’on peut compter tous leurs os. C’est là, mes frères une seconde cause qui peut amener les âmes à s’écrier : « Oh ! qui nous ferait être comme nous étions autrefois ».
Les livres de Charles Spurgeon en Pdf
➲ Articles à découvrir...
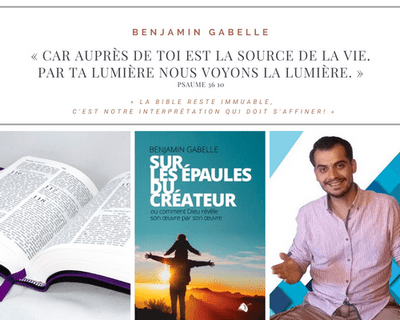
Un rappel à la foi

Caché en Christ
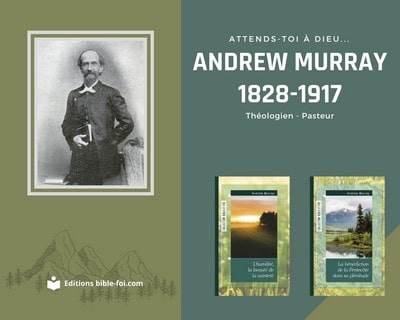
4. Demeurez en Christ
➲ REUNION SUR ZOOM
« La consécration, c'est recevoir le ministère de servir Dieu. C'est dire au Seigneur : « Aujourd'hui je me sépare de tout pour Te servir, parce que Tu m'as aimé.... »
- Watchman Nee
Edification
Enseignements
➲ NOUVEAUX EBOOKS
PDF Révisés