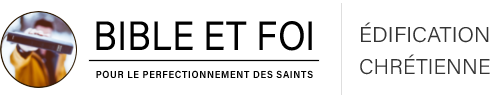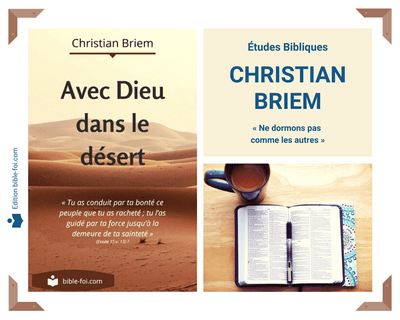
6. La mort, un ennemi vaincu
Chap: 3 - La venue du Seigneur et la victoire 15 v. 50 à 58 (suite) - Jusqu’ici, nous avons trouvé la réponse à la question : « Avec quel corps » (15 v. 35) Dieu va-t-Il revêtir les siens dans la résurrection ? Autrement dit : nous avons vu quel sera le caractère de la résurrection des croyants.
Deux pensées se lient à la résurrection d’entre : Elle est un signe de la faveur de Dieu à l’égard de ceux qui la connaîtront : Elle s’accompagne d’une séparation définitive du bien et du mal. Quand le Seigneur Jésus fut ressuscité par la gloire du Père, ce fut le signe extraordinaire du plaisir extrême que Dieu avait dans son Fils. Le Fils a glorifié Dieu d’une manière parfaite dans sa vie et dans sa mort. Y avait-il une manière autre, ou meilleure, pour Dieu de manifester son bon plaisir dans la personne de son Fils, qu’en le « ramenant d’entre les morts » (Hébreux 13 v. 20) ?
Il a été mis à mort par la main d’hommes iniques. Y avait-il une meilleure manière pour le Père d’honorer son Fils qu’en « le ressuscitant d’entre les morts » par sa gloire (Romains 6 v. 4) ? Et quand les saints seront ressuscités d’entre les morts, ce sera également le signe de la faveur particulière de Dieu à leur égard. Les autres morts resteront dans leur état de mort corporelle, mais Il prendra les siens du milieu d’eux pour les établir dans le monde glorieux de la résurrection de son Fils après les avoir revêtus d’un nouveau corps approprié. Combien cette vérité nous réjouit !
Or cette pensée nous console aussi par rapport à tous les tristes mélanges de vrai et de faux qu’on rencontre aujourd’hui : quand Dieu ressuscitera les saints d’entre les morts, cela s’accompagnera d’une séparation absolue, complète et irrémédiable des justes d’avec les injustes. Dieu a longtemps supporté dans la chrétienté le mélange de principes divins avec les principes du monde ; Il a longtemps regardé comment les fils du méchant se mêlaient aux fils du royaume (Matthieu 13 v. 36 à 43).
C’est sa longanimité qui l’a fait attendre, comme nous le savons (2 Pierre 3 v. 15). Mais alors, il séparera ce qui ne va pas ensemble. À la venue du Seigneur, cette séparation des saints d’avec les profanes sera achevée une fois pour toutes, et elle sera visible de tous lorsqu’Il sera manifesté publiquement. Nous ne pouvons que nous émerveiller du conseil de Dieu, nous ne pouvons que nous prosterner en adorant devant celui qui a eu dans son cœur de telles pensées au sujet de son Fils et de ceux qui croiraient en lui.
Tous seront changés (15 v. 51).
Mais dans tout ce que nous avons vu jusqu’ici, il reste en suspens la question de savoir ce qui arrivera à nous les vivants lors de la résurrection. Pouvons-nous aller dans la gloire avec nos corps terrestres ? C’est impossible, le verset 50 de notre chapitre le dit clairement. C’est le verset suivant qui donne la réponse à la question sur le sort des vivants : « Voici, je vous dis un mystère : Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés (ou : transmués) » (15 v. 51).
Le secret nous est révélé : nous ne nous endormirons pas tous, c’est-à-dire nous ne mourrons pas tous ! C’est la première chose que nous apprenons ici. Il y aura des personnes croyantes qui iront dans la gloire avec le Seigneur Jésus sans voir la mort et sans avoir à subir l’humiliation de la mort.
Certes, il est réservé à l’homme de mourir une fois (Hébreux 9 v. 27), mais nous chrétiens, nous sommes en relation avec le « second homme » venu du ciel (15 v. 47 à 49), et nous ne devons pas tous mourir. La mort est tellement vaincue que, si Christ revient suffisamment tôt, aucun des siens ne verra plus la mort. Voilà à quel point la puissance de la mort est anéantie pour nous. Nous voyons toujours plus clairement ce que signifie pour nous le fait que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus (15 v. 57). Quand le Seigneur reviendra, comme Sauveur de notre corps (Philippiens 3 v. 20), alors sa victoire, selon les pensées de Dieu, verra sa portée s’étendre à tous les croyants vivants.
Cela nous amène au second sujet de notre verset : les croyants vivants passeront par un changement (ou : transmutation). Pour confirmer cette affirmation, regardons d’un peu plus près la structure du verset. La proposition intermédiaire est une parenthèse, une insertion. Pour rendre encore plus clair le courant de pensée du v. 51, on pourrait mettre les deux signes de parenthèses devant et après la proposition « nous ne nous endormirons pas tous ».
La pensée principale, la merveille, c’est que nous serons tous changés. Pensons un peu à l’immensité de ce miracle : des personnes vivantes connaîtront la puissance de sa résurrection et vivront consciemment la transformation du corps de leur abaissement en la conformité de son corps de gloire (Philippiens 3 v. 21). En Philippiens 3 ce changement est décrit comme une transformation, et en 1 Corinthiens 15 v. 53 comme le fait de revêtir l’incorruptibilité.
Quand l’apôtre Paul parle de « nous tous » (« nous serons tous changés »), il pense manifestement à tous les croyants encore vivants à la venue du Seigneur, et il s’identifie à eux, il se compte parmi eux. Il considère la venue du Seigneur comme un événement pouvant intervenir à chaque instant, et ce n’est pas le seul passage où il le fait.
C’est pourquoi cela est exprimé comme une chose de l’époque actuelle, quelque chose d’attendu intérieurement par l’âme. Il soupire (et nous avec lui) non pas après le fait d’être dépouillé, mais après le fait d’être revêtu, « afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie » (2 Corinthiens 5 v. 4). Quel triomphe indescriptible de la grâce de Dieu ce sera.
La dernière trompette (15 v. 52).
Pour un changement aussi complet et aussi vaste des hommes mortels, faudra-t-il un temps long, un processus douloureux et de longue durée ? pas du tout, bien au contraire. La transformation sera instantanée : « en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette » (15 v. 52).
La répétition des expressions « en un instant », « en un clin d’œil », insiste sur l’instantanéité de l’événement. La première expression contient le mot « atome » (en grec : atomos), c’est-à-dire un processus qui se déroule durant un temps si petit qu’il est indivisible. Le changement n’aura pas de spectateur terrestre, car même le temps pendant lequel il aura lieu est trop court pour que des yeux naturels puissent le percevoir.
Or l’Esprit de Dieu rajoute quelque chose : « à la dernière trompette ». C’est ce qui décrit le caractère définitif du processus. En 1 Thessaloniciens 4, il est dit que le Seigneur Jésus descendra du ciel avec la « trompette de Dieu ». Ici, il est affirmé que le changement est achevé à la dernière trompette.
La « trompette de Dieu » est souvent dans la Parole de Dieu un symbole de la Parole de Dieu (Nombres 10) ; cette trompette de Dieu de 1 Thessaloniciens 4 a, bien sûr, le même sens que la « dernière trompette » de 1 Corinthiens 15, mais le point de vue est autre. Nous pouvons comprendre que l’expression « dernière trompette » est le signal puissant du départ définitif. Dans l’armée romaine, c’était le sens de la dernière de trois trompettes : lever le camp.
Notons bien que la « dernière trompette » n’a rien à voir avec la « septième trompette » d’Apocalypse 11. Certains commentateurs le prétendent, et renvoient l’enlèvement au temps du jugement final ; mais c’est intenable. Plusieurs autres considérations et autres liaisons le montrent, mais une pensée montre clairement qu’une telle argumentation manque tout à fait de consistance : l’apôtre Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens plus de trente ans avant que Jean ait la vision de l’Apocalypse à Patmos. Aucun croyant de Corinthe ne pouvait donc rien savoir sur les sceaux, les trompettes et les coupes. Pourtant l’intention de l’apôtre Paul était d’enseigner, et même de rectifier les Corinthiens au sujet d’une vérité fondamentale.
Ne serait-ce pas un manque de sérieux au plus haut degré, et même une absurdité, de se servir des symboles d’un livre qui ne devait être écrit que trente ans plus tard, alors que la plupart de ceux auxquels il écrivait auraient quitté cette terre depuis longtemps ?
Les symboles utilisés ne devaient-ils pas être totalement compréhensibles pour l’assemblée à Corinthe ? Leur utilisation devait-elle laisser les croyants devant des énigmes insolubles ? Comment pouvaient-ils prêter l’oreille aux enseignements et avertissements de l’apôtre si sa manière de parler n’était pas compréhensible ? En suivant l’argumentation mentionnée ci-dessus, on pourrait tout aussi bien prétendre que la trompette de 1 Corinthiens 14 v. 8 se rapporte pareillement aux trompettes d’Apocalypse.
D’un autre côté, ceux qui reçurent la première épître aux Corinthiens étaient tout à fait familiers avec les mœurs et habitudes des Grecs et des Romains, et l’apôtre se sert à plusieurs reprises d’images tirées de leur contexte culturel pour illustrer son enseignement. Pensez simplement aux compétitions sportives. De la même manière les croyants à Corinthe comprenaient très bien l’image de la « dernière trompette » : c’était le signal du départ prochain. Quand la trompette retentira, alors s’accomplira la première partie de la Parole du Seigneur au sujet de « ceux qui auront pratiqué le bien » :
« L’heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix ; et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien, en résurrection de vie ; et ceux qui auront fait le mal, en résurrection de jugement » (Jean 5 v. 28 et 29). Quelle puissance inimaginable se cache dans la voix du Fils de Dieu, quelle force elle déploiera.
Personne n’y échappera. Même les morts l’entendront, et y obéiront. Aussi est-il ajouté dans notre texte : « Car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés » (15 v. 52).
Ici, il s’agit seulement de morts endormis en Christ, comme nous l’avons déjà remarqué plus haut. Il est aussi remarquable de voir l’ordre dans lequel les deux groupes sont nommés : il est d’abord parlé des morts et de leur résurrection, puis de nous, les vivants et de notre changement (ou : transmutation). C’est le même ordre qu’on trouve en 1 Thessaloniciens 4. Bien que tout se déroulera dans un temps d’une brièveté inimaginable, il y aura quand même dans le cours des événements un « d’abord » et un « ensuite » (1 Thessaloniciens 4 v. 16 et 17).
À mon avis, il n’est pas correct de parler de changement à la fois pour les vivants et pour les morts. Dans les deux passages, ces deux groupes de croyants sont mentionnés et sont distingués l’un de l’autre : s’agissant des morts en Christ, il est parlé de résurrection ; s’agissant des vivants, il est parlé de changement (ou : transmutation).
La dernière trompette a à faire avant tout avec la résurrection des morts, mais elle est inséparablement rattachée au changement des saints vivants. Quelle pensée, bien-aimés : nous n’aurons ensuite plus jamais besoin d’une autre trompette. Si le Seigneur nous a premièrement appelés une fois à lui par sa puissance, nous serons et resterons pour toujours auprès de lui.
Incorruptibilité - Immortalité (15 v. 53).
Le verset 52 parle de ce que les morts ressusciteront incorruptibles. L’auteur reprend cette pensée dans ce qui suit et en donne le fondement : « Car il faut que ce corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce mortel revête l’immortalité » (15 v. 53).
Penchons-nous d’abord sur ce « il faut ». Pourquoi faut-il que ce corruptible revête l’incorruptibilité et que ce mortel revête l’immortalité ? Ici l’apôtre ne parle pas, bien sûr, d’un « il faut » dans le sens absolu, comme s’il s’agissait d’une loi de la nature valable en toute circonstance. Non, il s’agit plutôt d’un « il faut » de la grâce de Dieu, une nécessité qui découle de son amour pour nous et de son intention à notre égard.
S’Il veut nous amener à lui dans la gloire, alors ce changement doit avoir lieu. C’est un « il faut » de la grâce divine, semblable à celui qui anima le Seigneur Jésus quand il voulut rencontrer la femme de Samarie : « il fallait qu’Il traversât la Samarie » (Jean 4 v. 4). Il n’est pas dit : « il faut que le corruptible revête l’incorruptibilité, et que le mortel revête l’immortalité ». Ce serait une affirmation abstraite jamais vraie dans l’absolu. C’est pourquoi l’apôtre parle « de ce corruptible et de ce mortel », désignant concrètement par là notre corps humain actuel.
Celui-ci est effectivement corruptible (passager) et mortel comme on l’a déjà vu en rapport avec les versets 42 et 50. Il ne fait manifestement pas allusion aux deux classes de croyants déjà mentionnées. Certains commentateurs le pensent pourtant, en rattachant « corruptible » avec ceux qui sont morts, et « mortel » avec les croyants encore vivants, mais cette conclusion n’est ni déterminante ni satisfaisante.
Le mot grec pour « corruptible » n’a rien à faire avec la putréfaction, mais il donne l’idée de fugacité, de ruine, de corruption. C’est donc la nature du corps humain : même rempli de vie, il est mortel et absolument assujetti à disparaître, ce qui a normalement lieu par la mort. Le caractère « passager » est ainsi l’expression générale qui englobe tout, et qui inclut ce qui est « mortel ».
Mais arrivons-en au côté positif. Or celui-ci est décrit de manière caractéristique par des expressions négatives. Ce qui est passager doit revêtir « le caractère de ce qui n’est pas passager », et ce qui est mortel doit revêtir « le caractère ce qui n’est pas mortel ».
Pour nous et pour nos corps aussi, le ciel sera caractérisé par ce qui ne passe pas et qui est immortel. La Parole de Dieu décrit souvent le bonheur du ciel en nommant « ce qu’on n’y trouve plus », parce que c’est plus facile à comprendre pour nous. C’est ainsi qu’en Apocalypse 21 v. 4 il est dit : « et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine ; les premières choses sont passées ».
Et un peu plus loin : « et il n’y aura plus de malédiction… il n’y aura plus de nuit, ni besoin d’une lampe et de la lumière du soleil » (Apocalypse 22 v. 3 à 5). Ce que nous connaissons ici-bas par l’expérience de la souffrance n’aura plus lieu là. Combien cela est heureux et combien cela nous rend reconnaissants.
Encore un mot sur le terme « revêtir ». « Il faut que ce corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce mortel revête l’immortalité ». C’est sans doute une description imagée du changement par lequel nous passerons, mais c’est une expression particulièrement consolante. Naturellement cela ne veut pas dire que ce qui est passager et mortel subsiste en l’état, en étant simplement recouvert et caché par le nouvel habit de l’immuable et de l’immortel.
Il s’agit d’extrêmes plutôt incompatibles, de sorte qu’ils s’excluent mutuellement. Si nous devons revêtir le nouvel habit, il faut nécessairement avoir dépouillé l’ancien au préalable. Autrement dit, ce qui est passager et mortel sera passé pour toujours. Si les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre nous aperçoivent dans nos corps nouveaux, elles verront l’habit de la gloire, à la gloire éternelle de celui qui nous l’a conféré.
La mort engloutie en victoire (15 v. 54 et 55).
« Or quand ce corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : « La mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon ? où est, ô mort, ta victoire ? » (15 v. 54 et 55).
C’est déjà quelque chose de grand que Paul répète une nouvelle fois en entier les paroles des versets précédents, et il les grave ainsi profondément dans nos cœurs. La construction longue de la phrase avec le « quand » et le « alors » attire l’attention de nouveau et avant tout sur l’événement prodigieux lui-même, dont le poids est renforcé par la répétition des mots.
Le « quand » initial signifie aussi « dès que » ; autrement dit : maintenant, nous attendons encore cet instant ; il n’est pas encore là. Quand (dès que) le moment sera venu de se défaire du vêtement de ce qui est passager, et de revêtir le vêtement de gloire (cela aura lieu à la venue du Seigneur), alors la parole, « ce qui est écrit » se manifestera entièrement vraie. Le sens est bien que la parole a été écrite dans le passé, et qu’elle demeure telle quelle, inchangée et infaillible, jusqu’à aujourd’hui.
Or de quelle parole s’agit-il ? L’apôtre cite d’abord la première phrase d’Ésaïe 25 v. 8 : « La mort a été engloutie en victoire » ; il suit le sens du mot victoire en araméen, et est incontestablement guidé par l’Esprit Saint pour le faire.
Cette exclamation triomphale du prophète Ésaïe, « la mort est engloutie en victoire », est donc utilisée ici pour décrire la résurrection et le changement (ou : transmutation) des saints. Nous pouvons plutôt dire qu’elle leur est appliquée, car en fait, dans le passage cité ici seulement en partie, Ésaïe parle de l’accomplissement de l’espérance d’Israël quand le royaume sera introduit en puissance et en gloire.
Dieu ouvrira les yeux de son peuple terrestre et ôtera son opprobre de dessus toute la terre (Ésaïe 25 v. 8). Le voile, qui, comme une couverture, couvre tous les peuples en signe d’ignorance, sera détruit, littéralement « englouti ». Alors arrivera pour Israël le jour de son salut et de sa résurrection, et Israël chantera et dira : « Voici, c’est ici notre Dieu que nous avons attendu pour qu’Il nous sauve ; c’est ici l’Éternel, nous l’avons attendu ! Égayons-nous et réjouissons-nous dans sa délivrance » (Ésaïe 25 v. 9).
Parmi toutes les exclamations ardentes du prophète, l’apôtre ne choisit que celle-ci, et il a été guidé par l’Esprit pour l’appliquer directement aux croyants morts et vivants, et à leur union avec le Seigneur à sa venue.
Cette application était inconnue du temps de l’Ancien Testament, seul le Nouveau Testament la donne. Il en ressort deux points : d’une part les promesses de l’Ancien Testament peuvent avoir plus d’une signification et ont par conséquent souvent plus d’une manière d’être accomplie ; d’autre part, la venue du Seigneur pour enlever les siens précède « ce jour-là », lorsque l’opprobre de son peuple terrestre sera ôté de dessus toute la terre (Ésaïe 25 v. 8).
Ceux qui ont part à l’appel céleste auront déjà atteint leur place de repos éternel avant le rétablissement de toutes choses. Pour eux l’exclamation du prophète Ésaïe (« la mort est engloutie en victoire ») sera déjà devenue une réalité avant de s’appliquer à toute la terre.
Notons bien que l’apôtre ne reprend pas la citation de ce qui suit immédiatement dans le passage d’Ésaïe : « et le Seigneur, l’Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage ». Cette promesse est pourtant appliquée dans le Nouveau Testament dans un passage approprié, avant tout à celui dont la victoire est fêtée non pas sur la terre, mais dans le ciel, devant le trône et en présence de l’Agneau : « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux » (Apocalypse 7 v. 17).
Et encore une fois, à la fin du livre de l’Apocalypse, on retrouve ces mêmes paroles. Mais il s’agit là d’une description de l’état éternel et le passage d’Ésaïe est appliqué à toute la multitude des rachetés. Il sert, pour ainsi dire, de point final à toute l’histoire de la grâce : « et Il essuiera toute larme de leurs yeux » (Apocalypse 21 v. 4).
Cela ne veut pas dire que nous pleurerons dans le ciel, mais que le Dieu de bonté éloignera lui-même de nous tout souvenir de la peine vécue sur la terre.
Arrêtons-nous un peu, et laissons agir sur nous tout le poids, toute la puissance de ces communications… « Ô Dieu, quel propos à notre égard ! Aujourd’hui où nous traversons la peine, la maladie et la détresse, pensons qu’un jour, malgré tous les triomphes et succès apparents de la mort, elle sera « engloutie en victoire » pour nous personnellement. Nous te louons pour cela aujourd’hui, et nous le ferons éternellement. Amen ! »
Les livres de Christian Briem en Pdf
➲ Articles à découvrir...

2.Discerner la source de nos œuvres
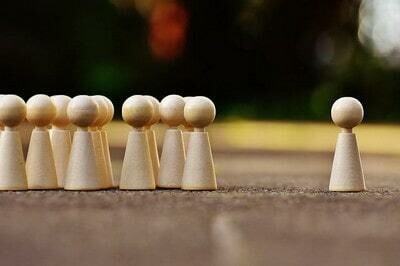
Le caractère central de la croix.6
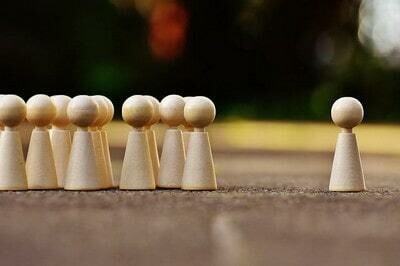
Le caractère central de la croix.2
➲ REUNION SUR ZOOM
« Le corps est la conscience du monde, l'âme est la conscience de soi, et l'esprit est la conscience de Dieu... »
- Watchman Nee
Edification
Enseignements
➲ NOUVEAUX EBOOKS
PDF Révisés