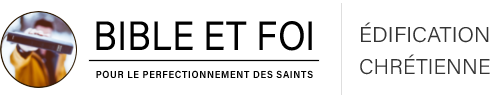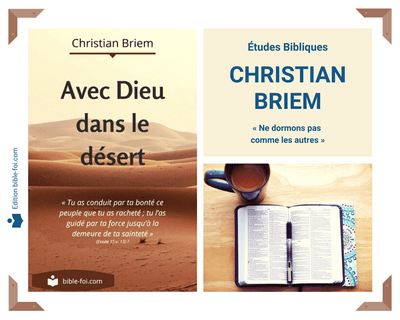
5. La mort, un ennemi vaincu
Chap: 3 - La venue du Seigneur et la victoire 15 v. 50 à 58 - Jusqu’ici, nous avons trouvé la réponse à la question : « Avec quel corps » (15 v. 35) Dieu va-t-Il revêtir les siens dans la résurrection ? Autrement dit : nous avons vu quel sera le caractère de la résurrection des croyants.
Mais nous n’avons encore rien su de précis quant au déroulement, au processus de la résurrection, c’est-à-dire : « Comment ressuscitent les morts » (15 v. 35). C’est maintenant le sujet élevé du reste du chapitre (15 v. 50 à 58). Le verset 50 part de ce qui a été dit jusque-là et constitue une sorte de transition vers le nouveau sujet placé devant nous, celui du changement ou de la transmutation des croyants. Il réinsiste encore une fois sur le fait que nous ne pouvons pas aller au ciel avec nos corps actuels.
Hériter du royaume de Dieu (15 v. 50).
« Or je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et la corruption non plus n’hérite pas de l’incorruptibilité » (15 v. 50).
L’apôtre s’adresse maintenant avec force et directement aux frères : « Or je dis ceci, frères ». Il est donc clair que pour avoir part au royaume de Dieu, peu importe sous quelle forme et en quel temps, nous, ceux qu’il appelle « frères », nous devons être nés de Dieu (Jean 1 v. 12 et 13 ; 3 v. 3 et 5). Pour en hériter, c’est-à-dire pour l’obtenir de l’autre côté de la mort, il nous faut en outre être transmués (ou changés).
La chair et le sang (15 v. 50).
« La chair et le sang » est la manière dont l’Écriture décrit ce qu’est l’homme ici-bas sur la terre. La condition humaine est caractérisée aujourd’hui par « la chair et le sang ». En tant que créature, c’est aussi ce qu’est l’homme quant à son corps : de la chair et du sang. Mais il ne faut pas confondre cette expression avec le péché, comme nous allons le voir en nous appuyant sur quelques passages de l’Écriture où cette expression revient avec le même sens.
Quand Pierre fit la confession unique en son genre de qui était le Seigneur Jésus, celui-ci lui répondit : « Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 16 v. 17).
De Paul, il est dit qu’il ne prit pas conseil « de la chair et du sang » quand il reçut mission d’annoncer le Fils de Dieu parmi les nations (Galates 1 v. 16). L’Écriture exprime de la manière suivante le fait que le Seigneur Jésus, dans sa grâce insondable, soit devenu un vrai homme (à part le péché) et ait pris part à notre condition humaine : « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même » (Hébreux 2 v. 14).
Le combat chrétien, en contraste avec celui d’Israël au temps de l’Ancien Testament, est aussi caractérisé comme n’étant pas contre le « sang et la chair » (c’est-à-dire contre des hommes) : « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes » (Éphésiens 6 v. 12).
Inversement, quand le Seigneur est apparu aux siens après sa résurrection d’entre les morts, Il ne possédait plus un corps fait de chair et de sang, mais Il put dire : « Voyez mes mains et mes pieds, que c’est moi-même ; touchez moi et voyez, car un esprit n’a pas de la chair et des os comme vous voyez que j’ai » (Luc 24 v. 39).
Mais revenons au point de départ : Même le croyant sauvé ne peut pas, avec le corps qu’il a aujourd’hui, hériter du royaume de Dieu, ni avoir part au royaume de Dieu de l’autre côté de la mort ; car tel est ici le sens exclusif du royaume de Dieu : le royaume de Dieu de l’autre côté de la mort. C’est le royaume de Dieu en gloire. Le « vase de terre » (2 Corinthiens 4 v. 7) que nous portons aujourd’hui n’est absolument pas approprié pour cela.
La phrase suivante expose les choses de manière encore plus radicale : « la corruption non plus n’hérite pas de l’incorruptibilité » (v. 50). Nous avons déjà vu plus haut que le mot « corruption » est mieux rendu par « le caractère éphémère, la fugacité, la décadence, la ruine ». Or, quant à leur corps, les enfants de Dieu sont des hommes comme les autres ; le même sort les attend, ils sont assujettis à ce qui est éphémère, bien que Christ soit en eux et qu’ils soient du Seigneur.
S’ils meurent, le caractère éphémère, la corruptibilité, sont visibles par tous, pour eux comme pour les autres. Or, il est impossible de transplanter cette condition éphémère dans la condition d’immortalité qui caractérise le ciel.
Après tout cela, une nécessité s’impose : pour avoir part à la gloire, les enfants de Dieu doivent subir une transformation allant au-delà de celle qu’ils ont déjà vécue quant à leur homme intérieur. L’apôtre en vient maintenant à parler de ce changement d’état. Le mystère lui en avait été confié par révélation spéciale.
Le changement des croyants (15 v. 51).
« Voici, je vous dis un mystère : Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés » (15 v. 51).
Par ce « voici ! », l’apôtre attire l’attention de ses lecteurs et la nôtre sur ce qu’il a maintenant à dire. Il s’agit d’une communication de portée extraordinaire pour nous tous. Et elle concerne la même série d’événements que celle dont parle l’écrivain inspiré dans sa première lettre aux Thessaloniciens (4 v. 15 à 17), et qui se lie étroitement à l’enlèvement des croyants.
Les deux passages de 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4, concernent les mêmes événements et se complètent l’un l’autre. Ils sont une preuve de plus qu’il est rare que l’Esprit Saint dise tout dans un seul passage. Nous avons effectivement besoin des deux passages pour avoir une image complète de chacune des étapes de l’enlèvement. Certaines particularités ne figurent que dans l’un des passages, et d’autres dans l’autre passage. Nous allons nous occuper avant tout des particularités qui figurent dans notre passage de 1 Corinthiens 15.
Un mystère (ou : secret).
Occupons-nous d’abord de l’expression « mystère ». Il est assez fréquent qu’on entende par là des choses mystérieuses, difficiles à comprendre, voire incompréhensibles, et un en outre un peu mystiques. Mais ce n’est pas le sens de « mystères » dans le Nouveau Testament.
Un « mystère » est une vérité de la Parole de Dieu, inconnue dans l’Ancien Testament, mais connue seulement par révélation de la part de Dieu dans le Nouveau Testament, et qui, quant à nous, ne peut être saisie que par la foi. Les « mystères » sont donc des vérités du Nouveau Testament qui ne sont pas encore révélées dans l’Ancien Testament.
C’est pourquoi l’expression « mystère » n’apparaît guère dans l’Ancien Testament, et quand on la rencontre quand même, c’est avec un autre sens : « communications intimes » (Psaume 25 v. 14 ; Proverbes 3 v. 32 ; Amos 3 v. 7).
Inversement, les mystères dans le Nouveau Testament ont pour contenu les pensées divines et le conseil de Dieu. Ils étaient certes dès le commencement dans le cœur de Dieu, mais ils étaient cachés et inconnus au temps de l’Ancien Testament. Or maintenant Dieu les a révélés à ses saints apôtres et prophètes (ceux du Nouveau Testament ; Éphésiens 3 v. 5), qui à leur tour les ont retransmis et expliqués, de sorte que nous pouvons les trouver aujourd’hui dans les pages du Nouveau Testament. Pour nous chrétiens du temps de la grâce, ce ne sont donc plus des mystères ou secrets cachés, mais des mystères ou secrets révélés.
Ce n’est pas la place ici, d’approfondir les douze mystères mentionnés dans le Nouveau Testament. Donnons quand même brièvement l’indication de leur contenu. À noter que le « mystère » peut aussi se rapporter à des développements mauvais :
1. Le mystère du royaume des cieux ou du royaume de Dieu (Matthieu 13 v. 11 ; Marc 4 v. 11 ; Luc 8 v. 10).
2. Le mystère du rétablissement d’Israël (Romains 11 v. 25).
3. Le mystère de la transmutation des croyants lors de la résurrection des saints (1 Corinthiens 15 v. 51).
4. Le mystère de toutes choses réunies sous une tête dans le Christ (Éphésiens 1 v. 9 et 10).
5. Le mystère de l’unité des croyants Juifs et des croyants des nations (Éphésiens 3 v. 4 à 6).
6. Le mystère du lien intime de l’assemblée avec Christ (Éphésiens 5 v. 32).
7. Le mystère de l’Évangile (Éphésiens 6 v. 19).
8. Le mystère d’iniquité (2 Thessaloniciens 2 v. 7).
9. Le mystère de la foi (1 Timothée 3 v. 9).
10. Le mystère de la (vraie) piété (1 Timothée 3 v. 16).
11. Le mystère des sept étoiles et des sept lampes d’or (Apocalypse 1 v. 20).
12. Le mystère de Babylone la prostituée (Apocalypse 17 v. 5).
La résurrection dans l’Ancien Testament.
Après cet aperçu des divers mystères du Nouveau Testament, revenons au mystère de 1 Corinthiens 15 v. 51. Disons d’abord nettement que la résurrection elle-même n’est pas un mystère. La résurrection des justes et des injustes était une vérité fondamentale connue dans l’Ancien Testament, même si les passages qui en témoignent sont relativement peu nombreux.
Donnons un coup d’œil à ces passages. Ils sont si précieux et ils fortifient tellement la foi en eux-mêmes, que le contraste par rapport à ce qui en est révélé dans le Nouveau Testament, en ressort d’autant plus clairement. Il est incontestable que les croyants de l’Ancien Testament croyaient à la résurrection. L’exemple de Job, un des plus anciens patriarches de l’Écriture l’établit tout à fait clairement. Nous l’avons déjà vu dans l’introduction à cet ouvrage.
Les patriarches de la Genèse croyaient aussi à la résurrection. Abraham acheta pour lui la caverne du champ de Macpéla devant Hébron, il était en communion avec les pensées de Dieu (Hébron signifie « communion »), et il y enterra Sara sa femme ; tous les patriarches y enterrèrent leur femme, et les fils de Jacob y enterrèrent leur père (Genèse 50 v. 13). Après avoir séjourné un grand nombre d’années dans le pays d’Égypte, Joseph sentit sa fin approcher et dit à ses frères : « Je meurs, et Dieu vous visitera certainement, et vous fera monter de ce pays-ci dans le pays qu’il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les fils d’Israël, disant : Certainement Dieu vous visitera, et vous ferez monter d’ici mes os » (Genèse 50 v. 24 et 25).
Des siècles plus tard, Moïse se souvint de la parole de Joseph, et nous lisons en Exode 13 v. 19 : « Et Moïse prit les os de Joseph avec lui, car il avait expressément fait jurer les fils d’Israël, disant : Certainement Dieu vous visitera ; et vous ferez monter mes os d’ici avec vous ».
Ce n’est que sous Josué que les os de Joseph arrivèrent dans le pays de Canaan : « Et on enterra à Sichem les os de Joseph, que les fils d’Israël avaient transportés d’Égypte, dans la portion de champ que Jacob avait achetée des fils de Hamor, père de Sichem, pour cent kesitas » (Josué 24 v. 32).
Peut-être quelqu’un demandera : pourquoi prendre tous ces soins pour des os morts ? Nous croyons qu’il n’y a qu’une réponse à cela : Les patriarches voyaient à l’avance leur résurrection, et ils voulaient être dans le pays de la promesse quand elle aurait lieu (Hébreux 11 v. 15 et 16).
Daniel était venu tout jeune à Babylone et il y reçut des révélations très vastes sur les temps futurs ; il est certainement arrivé à un âge très avancé, car sa vie couvrit plusieurs dynasties. Il vit l’émergence et la chute de l’empire babylonien, et il vécut jusqu’à la prise du pouvoir par Cyrus le Perse. Quand Daniel arriva à la fin de son livre et de sa vie, Dieu lui parla de la résurrection : « Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour être un objet d’horreur éternelle » (Daniel 12 v. 2).
Même si ces paroles concernent spécialement la résurrection nationale du peuple d’Israël, Dieu ne laissa pas son fidèle serviteur quitter ce monde sans l’espérance de sa résurrection personnelle : « Et toi, va jusqu’à la fin ; et tu te reposeras, et tu « te tiendras » (litt. en allemand : tu ressusciteras) dans ton lot, à la fin des jours » (Daniel 12 v. 13).
L’espérance de la résurrection n’est pas une vérité spécifiquement chrétienne, comme cela ressort des paroles de l’apôtre Paul à Agrippa en Actes 26 : « Et maintenant je comparais en jugement pour l’espérance de la promesse faite par Dieu à nos pères, à laquelle nos douze tribus, en servant Dieu sans relâche nuit et jour, espèrent parvenir ; et c’est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs » (Actes 26 v. 6 et 7).
Et il poursuit en disant : « Ayant donc reçu le secours qui vient de Dieu, me voici debout jusqu’à ce jour, rendant témoignage aux petits et aux grands, ne disant rien d’autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé devoir arriver, savoir qu’il fallait que le Christ fût soumis aux souffrances, et que, le premier, par la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière et au peuple et aux nations » (Actes 26 v. 22 et 23).
Le Seigneur Jésus devait être le premier à annoncer la lumière par la résurrection des morts. Or c’était là la promesse faite aux pères d’Israël.
Au ch. 13 des Actes, nous trouvons encore une citation précieuse, tirée du psaume 16, qui parle également de la résurrection du Seigneur Jésus : « Et nous, nous vous annonçons la bonne nouvelle quant à la promesse qui a été faite aux pères, que Dieu l’a accomplie envers nous, leurs enfants, ayant suscité Jésus ; comme aussi il est écrit dans le psaume second : « Tu es mon Fils, moi je t’ai aujourd’hui engendré ».
Or qu’il l’ait ressuscité d’entre les morts, pour ne devoir plus retourner à la corruption, il l’a dit ainsi : « Je vous donnerai les grâces assurées de David ». C’est pourquoi il dit aussi dans un autre endroit : « Tu ne permettras point que ton saint voie la corruption ». Car David, après avoir, en sa propre génération, servi au conseil de Dieu, s’est endormi, et a été réuni à ses pères, et a vu la corruption ; mais celui que Dieu a ressuscité, n’a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que par lui vous est annoncée la rémission des péchés » (Actes 13 v. 32 à 38).
Le Seigneur Jésus est ressuscité, c’est un point fondamental du christianisme, comme nous l’avons vu.
Encore un élément caractéristique de l’espérance des croyants de l’Ancien Testament à l’égard de la résurrection : elle ne portait que sur une nouvelle vie sur la terre. Or, est-ce là l’espérance du chrétien, est-ce cela le contenu du « mystère » ? Nous allons bientôt voir que non.
Ainsi, il est ouvertement parlé dans l’Ancien Testament de la résurrection, tandis que dans le Nouveau, il est parlé d’un mystère (ou : « secret ») : cela est un démenti à tous ceux qui prétendent qu’on ne trouve rien d’une venue du Seigneur pour les siens, et que quand les morts sont ressuscités et que les vivants sont transmués, il s’agirait de la venue visible de Christ à la fin de la grande tribulation.
Nous devons nous opposer à cela : la venue visible de Christ est l’objet de la révélation dans tout l’Ancien Testament. La parole prophétique en parle dans plusieurs passages. Ce n’a jamais été un secret. Mais ce dont nous parlons maintenant est une nouvelle révélation, c’est un mystère (ou : secret).
On ne peut pas mettre sur le même plan la venue du Seigneur pour enlever les saints et son apparition en puissance et en gloire. L’Écriture Sainte dissocie clairement ces deux aspects de la venue du Seigneur, spécialement dans les deux épîtres aux saints de Thessalonique.
Une résurrection d’entre.
Nous avons entendu le témoignage des écritures de l’Ancien Testament sur la résurrection, et nous avons vu comment Paul en parle dans les Actes en citant l’Ancien Testament. Mais l’apôtre, et avant lui le Seigneur Jésus lui-même, utilise une expression qu’il faut regarder d’un peu plus près : la résurrection des justes sera une « résurrection d’entre ». Nous faisons par là un pas essentiel en direction du contenu véritable du mystère.
Quand le Sauveur a parlé pour la première fois à ses disciples de ce que le Fils de l’homme, après avoir souffert, « ressusciterait d’entre les morts », ils ne comprirent d’abord pas ce dont il parlait, et ils se dirent l’un à l’autre : « qu’est-ce que cela, ressusciter d’entre les morts ? » (Marc 9 v. 9 et 10). Nous pouvons bien les comprendre : ils connaissaient certes la résurrection, la résurrection au dernier jour selon Jean 11 v. 24 ; cependant ils ne connaissaient pas encore ce côté de la vérité. Quel en est le sens ?
La « résurrection d’entre », signifie que certains ressuscitent d’entre les morts, tandis que la masse des autres morts restent en l’état. Le grand exemple de cela en est la résurrection du Seigneur Jésus lui-même (Actes 13 v. 34 ; 1 Corinthiens 15 v. 20).
Mais la résurrection de Lazare en donne aussi une image (Jean 11 v. 43 et 44). Lors de la résurrection des morts devant le grand trône blanc, aucune sélection n’a lieu, car il s’agit alors exclusivement de gens morts dans leurs péchés, des impies. Le moment venu, ils doivent tous ressusciter, et aucun n’échappera : « Après cela le jugement » dit Hébreux 9 v. 27.
Pensée sérieuse, effrayante, mais qui montre aussi clairement qu’il n’y a pas ce qu’on appelle une résurrection générale, de tous les morts au même moment. La première résurrection sera une « résurrection d’entre ». Cette expression se retrouve en Philippiens 3 v. 11.
Pour être le plus possible semblable à son cher Seigneur, l’apôtre Paul avait le désir ardent de parvenir lui aussi à cette résurrection d’entre les morts.
Les livres de Christian Briem en Pdf
➲ Articles à découvrir...

9. L’Esprit du Christ
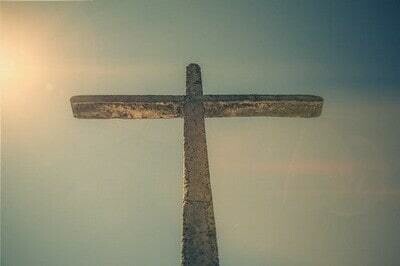
Un deuxième regard sur le Sauveur

Études sur la Parole.32
➲ REUNION SUR ZOOM
« La qualité d'une réunion d’église ou d'un groupe de maison dépend de la qualité de notre marche personnelle et collective avec le Seigneur. La profondeur appelle la profondeur. »
- Laurence Dene McGriff
Edification
Enseignements
➲ NOUVEAUX EBOOKS
PDF Révisés